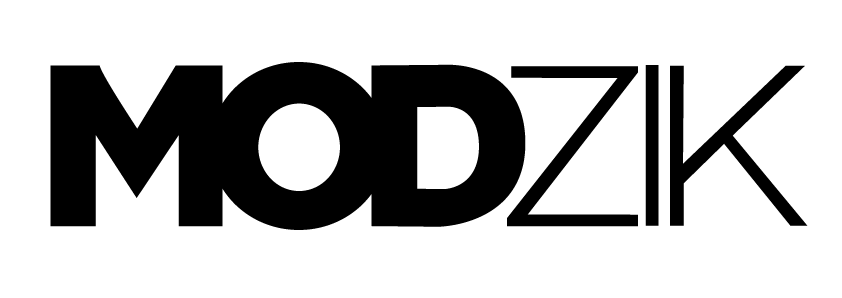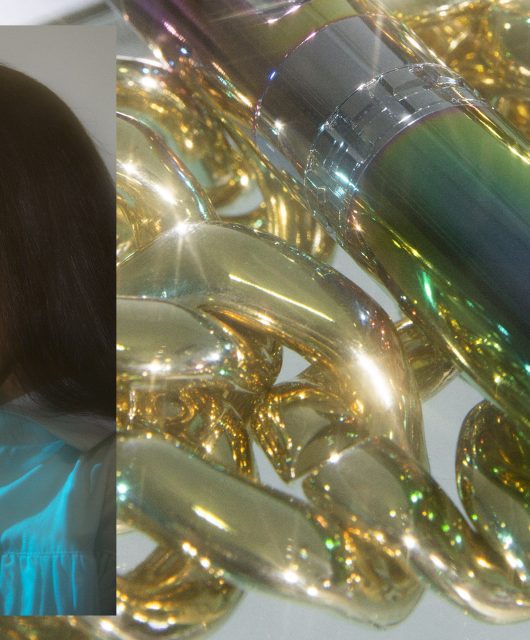Nous avons rencontré Madlib à Francfort, à la veille de sa tournée européenne. Généreux, pesant chaque mot, il n’a éludé aucune question et s’est prêté avec le sourire à la séance photo. Nous avons poursuivi l’entretien avec Egon et Jeff Jank, ses deux plus proches collaborateurs, et Geoff Barrow, l’âme de Portishead.
Je sais que vous n’aimez pas les interviews…
C’est vrai, c’est de notoriété publique maintenant… Disons que je suis un homme de peu de mots.
Comment se passe cette première tournée avec Freddie Gibbs ?
Je suis très heureux. Le public, qui ne me connaît que par mon côté jazz, découvre un autre aspect de ma musique. Mais j’écoute du gangsta rap, depuis que je suis gamin, et j’aime ça. Cette association avec Freddie n’est pas du tout contre-nature pour moi.
Cette collaboration est, de fait, assez inattendue…
Oui, peut-être, parce que Freddie est un peu plus mainstream que les autres rappeurs avec lesquels je travaille. Il traîne avec des types comme Young Jeezy ou 2 Chainz…
Et vous avez pris cela comme un challenge ?
Non, parce que ce n’est pas vraiment différent. Je sais comment Freddie rappe, et je m’adapte. Je peux travailler avec n’importe qui. Finalement, c’est toujours la même chose.
L’un de vos premiers beats, c’était « Mary Jane » pour les Alkaholiks. Comment avez-vous rencontré le groupe ?
Oui, c’était en 1993, cela fait un bail… En fait, Wildchild (N.D.L.R. : deu- xième rappeur du groupe Lootpack) connaissait l’un des membres, Tash, qui traînait pas mal du côté d’Oxnard, où nous vivions tous. Il a aimé mes beats et m’en a demandé un. Je me souviens que Kankick (N.D.L.R. : autre éminent producteur d’Oxnard) m’a filé un coup de main pour « Mary Jane ». Ensuite, nous avons enregistré le morceau « Turn Tha Party Out » avec Lootpack, qui s’est aussi retrouvé sur l’album 21 & Over des Alka- holiks…
Vous aviez déjà créé Lootpack, à cette époque-là, mais vous n’aviez encore rien sorti sous votre nom…
En effet. Mon père nous a aidés à financer notre premier EP qui est sorti 2 ans plus tard, en 1995. Il a créé un label, pour nous, qui s’appelait Crate Diggas Palace. Et c’est après cela que nous avons rencontré Peanut Butter Wolf…
Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles Peanut Butter Wolf est entré en contact avec vous ?
C’est mon père qui lui a montré le disque, pour tout dire. Wolf a aimé le single et a voulu signer pour un album sur Stones Throw.
Cela marque le début d’une très longue collaboration quasi-exclusive avec Stones Throw.
Oui, j’avais une liberté totale, donc aucune raison d’aller voir ailleurs. En plus, j’arrivais à peu près à en vivre, je n’avais pas besoin de plus.
Après Lootpack et en parallèle à votre carrière solo, vous avez commencé à produire de nombreux morceaux, et des albums entiers, pour la petite bande des rappeurs d’Oxnard : Medaphoar (alias M.E.D.), Wildchild, votre frère Oh No… M.E.D. nous disait, il y a quelques mois (N.D.L.R. : voir Modzik #24), que vous étiez les seuls à vous agiter dans le coin, qu’il n’y avait pas, à proprement parler, de scène à Oxnard avant Lootpack.
C’est vrai, personne ne nous prenait au sérieux. Nous nous baladions avec d’énormes pendules autour du cou, nous avions monté un groupe de rap. Nous passions pour des pestiférés, jusqu’à ce que le disque sorte, et que l’on commence à en parler. Il y a eu un peu de presse, nous sommes passés à la radio, et tout a été différent : nous étions les mecs cool du coin, mais nous sommes restés entre nous.
Puis, vous avez emménagé à L.A. avec Peanut Butter Wolf…
Oui, vers 1999, 2000, Egon et moi avons, tous les deux, déménagé à Los Angeles. Nous y avons retrouvé Wolf et Jeff Jank (N.D.L.R. : responsable des visuels et du web chez Stones Throw). Cela nous semblait plus pratique et plus stimulant d’être tous au même endroit.
C’est dans cette maison que vous avez commencé à travailler sur Quasimoto,Yesterday’s New Quintet et les autres projets que vous avez sortis au début des années 2000 ?
Quasimoto est né à Oxnard, avant même que l’album de Lootpack ne sorte. C’est la même chose pour Yesterdays New Quintet, mais tout s’est concrétisé dans cette maison à L.A.. Je n’ai pas été plus productif à cette époque qu’avant de m’installer à Los Angeles. C’est juste que j’avais une structure pour sortir des disques plus facilement et quand je le désirais, et je ne me suis pas fait prier.
C’est néanmoins à cette période que vous vous êtes mis sérieusement à jouer de la batterie, de la guitare, du vibraphone… Jeff Jank nous racontait qu’il vous avait, plusieurs fois, surpris derrière la batterie en pleine nuit dans cette maison de Los Angeles…
J’ai commencé très jeune à toucher aux instruments, mais je n’ai jamais vraiment appris à jouer de la musique, je voulais juste prouver et me prou- ver qu’on pouvait écrire et jouer de la musique sans savoir la lire, qu’on pouvait apprivoiser tous les instruments sans être pour autant ce qu’on appelle un musicien. Je n’écouterais pour rien au monde ce que j’ai enregistré à cette période, c’était très approximatif… J’essayais de recréer ce que j’entendais et je voulais tout essayer.
Auriez-vous sorti autant de disques et pu expérimenter à ce point, si vous n’aviez pas eu ce contexte si particulier et cet entourage presque exclusive- ment à votre service, pendant ces années-là ?
De fait, je me sentais en confiance et la situation était confortable, mais je pense que les choses se seraient passées de la même manière ailleurs, si toutefois on m’avait laissé la même liberté. Tout est une question de liberté de création.
Il n’y avait pas de direction artistique proprement dite ? Vous étiez vraiment libre à 100%?
Non, pas de direction artistique pour mes projets chez Stones Throw. Je faisais ce que je voulais et Wolf décidait de le sortir ou non. Je ne m’intéressais pas à la stratégie une fois que l’album était terminé. Comme pour les visuels de Jeff. C’était leur part du job. Moi, je passais à autre chose, je reprenais un autre travail en cours.
Après l’album de Lootpack, les premiers Quasimoto et Yesterdays New Quin- tet, vous avez ensuite enclenché deux projets très ambitieux avec J Dilla et MF Doom.
Oui, ce sont mes deux plus gros disques… Ceux qui ont connu le plus de succès.
Cette collaboration avec J Dilla, vous la voyez comme un tournant ?
J Dilla, c’était le roi. Pour ma génération, il était le plus grand, sans aucun doute. Et on s’entendait bien, on échangeait des beats en permanence et puis, on en est venus à faire cet album ensemble… Je devais déjà travailler sur un album avec lui en 2001, il était prévu que je le rejoigne à Detroit, mais le 11 septembre a repoussé cette rencontre. C’est quand il a emme- nagé à L.A. que nous avons commencé à travailler.
Vous avez passé du temps avec lui en studio ?
En fait, non. Nous avons travaillé chacun de notre côté, nous échangions des bandes et des idées, et cela a bien pris. C’est comme cela que j’ai toujours fonctionné, je n’ai, pour ainsi dire, jamais été en studio avec un autre artiste. Je choisis mes collaborations en fonction des affinités, et je fais toujours en sorte que cela puisse se passer ainsi.
Mais vous avez dérogé à cette règle pour Madvillain. Vous vous êtes enfermé avec MF Doom pendant quelques semaines, n’est-ce pas ?
Oui, en effet. Il était difficile de faire autrement avec Doom car il serait toujours en train d’écrire les textes si on ne l’avait pas enfermé. Et même enfermé, il réécrivait sans cesse ses lyrics, voulait refaire des prises, encore et encore. Je dois avoir au moins cinq versions de chaque morceau de l’album. On passait la journée à écrire, à boire et à se droguer. Il dormait à l’hôtel et débarquait le matin déjà très abîmé… C’était épique, mais le résultat sonne bien, je crois.
Comment expliquez-vous qu’un album aussi expérimental et hors-format que Madvillainy ait eu un tel succès ?
J’ai encore du mal à le concevoir, en fait. C’est un album tellement sale et rugueux… Je pensais que Jaylib (N.D.L.R. : projet commun avec J Dilla) toucherait bien plus de monde. Mais je crois que c’était juste le bon moment, pour Doom comme pour moi.
Pensez-vous que le même album aurait pu sortir sur une major ?
Je ne pense pas qu’il aurait pu être compris par l’industrie. Et même si un directeur artistique avait pris le risque, les chiffres n’auraient pas été à la hauteur de leurs standards, donc c’est mieux comme cela. Nous n’avons pas du tout réfléchi en termes de singles ou de passages radio. Je ne le fais jamais, d’ailleurs, j’aborde un album comme un tout indivisible.
Comment avez-vous vécu l’expérience Blue Note ?
Evidemment, je l’ai vécue comme une chance et un honneur. J’ai rencon- tré Eli Wolf, qui était, à l’époque, directeur artistique chez Blue Note. Il connaissait et aimait la plupart de mes disques, et il m’a tout simplement laissé faire ce que je voulais avec le catalogue du label pour Shades of Blue. J’ai eu accès aux pistes séparées de standards du jazz moderne, des milliers de morceaux, c’était vertigineux et excitant.
Avez-vous déjà imaginé sortir vos projets jazz sur des labels spécialisés ?
Non, je ne crois pas que cela marcherait. Je n’existe pas pour eux. De toute façon, de nos jours, il vaut mieux tout sortir tout seul, peu importe le style de musique…
Quel rapport entretenez-vous avec Peanut Butter Wolf et Stones Throw aujourd’hui ? Peut-on dire que vos chemins se sont séparés ?
Nos rapports sont bons. Je travaille encore avec Stones Throw, mais je me concentre sur mes propres projets via la structure Madlib Invazion. J’essaie de trouver un nouveau modèle artistique et économique, j’ai presque 40 ans et cela me semble le bon moment pour voir ailleurs et plus loin.
Cela nous amène justement à une nouvelle étape de votre carrière et au projet Medicine Show (N.D.L.R. : treize disques sortis en un peu moins de 2 ans). Est-ce qu’on peut l’appréhender comme une sorte de rétrospective ?
Oui, car j’aborde plein de genres et de formats différents, comme je l’ai fait tout au long de ma carrière. Des beat-tapes, des albums avec des rappeurs, des compilations de jazz, de funk, des remixes… J’en ai encore beaucoup dans les tiroirs, il y a des choses que je ne sortirai jamais, mais avec le Medicine Show, on a un bon échantillon.
Vous n’utilisez toujours pas d’ordinateur ?
Je travaille un peu sur iPad ces derniers temps, je dois admettre que c’est très pratique. Mais l’important ne sera jamais ce qu’on utilise pour faire de la musique. Le matériel est un moyen, pas une fin. J’utilise principalement ma collection de disques, quelques machines assez simples, un clavier…
Outre votre album avec Freddie Gibbs, qu’est-on en droit d’attendre de votre part dans les prochains mois ?
J’ai des albums instrumentaux en route, un album de Quasimoto, des disques avec des chanteurs, le deuxième Madvillain est a moitié enregis- tré, mais je ne sais pas s’il sortira un jour… Je suis, aussi, de plus en plus intéressé par les sonorités électroniques, j’écoute beaucoup de disques électroniques des années 70.
Qu’écoutez-vous d’autres ces derniers temps ?
Encore et toujours J Dilla. Flying Lotus, Alchemist & Oh No… J’écoute à peu prè.s tout pour ce qui est du hip-hop, mais également beaucoup de vieilles choses dans des genres très différents… David Axelrod, par exemple.
Merci à Ludivine Grétéré.
Madlib & Freddie Gibbs, Shame EP (Madlib Invazion) Madlib, Medicine Show : The Brick (Madlib Invazion) www.rappcats.com
www.stonesthrow.com/madlib
Propos recueillis (à Francfort) par Damien Besançon
Photos Vicky Trombetta
Réalisation Flora Zoutu