Depuis la première fois qu’on a entendu – et aussi vu – le fameux Iron de Woodkid en mars 2011, jusqu’à l’apothéose du fameux concert orchestral donné au grand Rex à grand renfort de cordes, c’est la porte sur un nouvel univers qui s’est ouverte devant nous. L’œuvre de Woodkid aka Yoann Lemoine, aka le clippeur des pop stars – de Lana del Rey à Katy Perry en passant par Drake avec Rihanna – nous bouleverse avec sa dualité : la force épique à la fois de sa musique, mais aussi de l’imagerie qu’il développe, sans oublier l’émotion à fleur de peau et le romantisme qui se dégagent autant de sa voix que de son oeuvre. Rencontre avec l’instigateur de cette mythologie peu commune…
Pour beaucoup, tu symbolises un peu l’avènement d’une sorte d’artiste 2.0 qui propose, à la fois, un univers musical personnel, mais aussi une dimension visuelle qui sert complètement ce dernier. Qu’en est-il vraiment et qui est Woodkid, ton alter ego ?
Pour moi, c’est vraiment le résultat de ce que je suis, de ce que j’ai appris, des milieux desquels je suis issu : le milieu de la mode dans lequel je travaille beaucoup ; ma passion pour le vêtement ; l’art contemporain ; le cinéma puisque je suis réalisateur ; le jeu vidéo car je suis aussi un gros gamer ; évidemment, mon passé de musicien ; les gens, aussi, avec qui je travaille comme ceux pour qui je fais des clips. Cela fait longtemps que je fais de la musique juste pour moi, mais assez vite, je me suis dit que je devais faire des maquettes et les présenter. Quant à lier image et musique, pour moi, c’est rigoureusement indissociable.
Quel est ton point de départ ?
J’ai appris la musique lorsque j’étais jeune et, ensuite, je me suis lancé dans les études supérieures, une maîtrise d’Arts appliqués, et c’est ce qui m’a permis d’éduquer mon œil. J’ai toujours été fort en dessin, j’étais intrigué par les phénomènes visuels, les ombres portées, les réflexions, etc. C’est pourquoi je me suis assez vite tourné vers la 3D, la post-production, parce qu’il y avait une approche quasi scientifique et mathématique de l’image qui m’intéressait. En parallèle, j’ai toujours fait un peu de musique et c’est par hasard que j’ai découvert que je pouvais faire résonner ma voix de manière totalement différente en contre-chantant. C’était d’une part, moins douloureux, mais aussi plus joli, et cela me permettait de véhiculer mes émotions d’une meilleure manière. J’ai réalisé ces petites maquettes à la guitare que j’ai fait écouter à Pierre Le Ny qui montait son label Gum records. A la base, c’était plutôt folk, dans l’esprit du titre « Brooklyn » qui est sur le premier EP. On a exploré plusieurs facettes de ce que je voulais faire musicalement et chemin faisant, on est tombés, une fois encore, par hasard sur Iron : j’avais une sorte d’intuition étrange que je voulais faire de la musique de péplums, quelque chose de très cinématographique. On est donc partis sur Iron et la vidéo a suivi.
Iron semble avoir été un catalyseur de beaucoup de choses pour toi…
Tout à fait, cela m’a boosté à tous les niveaux : le succès du clip m’a crédibilisé en tant que réalisateur. Avec ce projet, j’ai fait d’une pierre deux coups, d’une manière très égale. Et j’ai pu mener de front mes activités de réalisation et la musique.
Avais-tu des velléités de devenir chanteur ?
Je n’ai jamais voulu être chanteur, mais j’ai toujours voulu chanter. Cela m’a toujours permis d’exprimer des émotions que je ne pouvais pas livrer autrement. Je me souviens, plus jeune, de moments particuliers où, ma mère et moi, on chantait dans la voiture, comme tout le monde, j’imagine. Mais moi, cela me touchait beaucoup en mon fort intérieur. Et un jour, je me suis rendu compte, qu’au lieu de faire résonner ma voix de manière nasale, je pouvais le faire par en bas. J’ai alors découvert ma voix chantée, et cela a même transformé ma voix parlée par la suite.
Même si c’est devenu un peu la tarte à la crème des références cinématographiques, on peut déceler chez toi une sorte d’analogie à Tim Burton. Comme lui, on sent qu’il faut une clef pour accéder à ton univers qui est aussi complexe que composé d’influences assez diverses, qu’en est-il ?
C’est bien la pire référence que l’on peut me citer, car je déteste Tim Burton ! [Rires] Mais je comprends l’analogie avec le côté symboliste fantastique et cette identité assez répétitive et obsessionnelle qui est importante pour moi dans mon art. Je trouve qu’on reproche trop souvent ce côté répétitif dans le monde artistique, alors que c’est, à mon sens, une grande qualité : c’est important pour un artiste d’affirmer ses obsessions, ses intuitions, ses certitudes, ses envies… Et on réussit rarement tout la première fois, donc il faut se remettre à l’ouvrage pour arriver à polir le tout : tout cela n’est qu’artisanat, finalement ! Un menuisier va refaire plusieurs fois le même meuble avant de maîtriser son art, un couturier va reproduire le même vêtement avant d’arriver à trouver le bon patron, le bon modelé, la bonne technicité et c’est que j’essaie de faire aussi.
Mais comment passe-t-on de la maquette toute simple à de la musique de péplum, comme tu le dis ?
Quand je me suis retrouvé en studio avec The Shoes, je leur ai annoncé qu’on allait suivre une sorte de charte qui définirait mon son, un peu comme Lars Von Trier aurait pu le faire, à l’époque, avec le Dogme. Mon idée était de faire de la pop music, mais sans utiliser les instruments habituels de la pop, donc pas de batterie, pas de basse, aucune guitare. Mais on va charter avec un orchestre avec des percussions, des sons semi-électroniques, semi-tribaux, on va « kiter » tout ça et monter le tout, comme de la musique électronique. Et pour la vidéo, qui était pour moi la symétrie de cette démarche sonore, c’était le noir et blanc, cet esthétisme emprunté à l’Europe de l’Est (N.D.L.R. : il est à moitié Polonais par sa mère), une sorte de constructivisme modélisé… Et comme en musique, je me suis aussi imposé une charte pour l’image, cette fois : on oublie les décors, on va raconter des histoires par les personnages, mais on va oublier l’environnement, on va laisser ces espaces ouverts pour que les gens puissent s’approprier tout cela comme ils l’entendent : certains voient cela comme un shoot de mode, d’autres comme un univers d’heroic fantasy ou comme du Tim Burton. Avec ce projet à la fois musique et image, je voulais laisser certains éléments vides et que le reste soit très cohérent et répétitif. J’ai l’impression que, dans le monde d’aujourd’hui qui va toujours plus vite avec une proposition médiatique toujours plus foisonnante, il est important de se répéter et de parler très fort, à partir du moment où l’on fait les choses bien, et j’ose espérer que c’est mon cas.
Et pourtant, ton projet a une dimension romantique et intimiste…
J’essaie de balancer ce côté un peu grandiloquent et épique avec la voix. Autant d’un côté, il y a cette ampleur de production qui m’était chère, autant pour la voix, j’ai essayé d’éviter de faire la diva ou d’en faire trop pour contre- balancer tout cela. Pour aller plus loin, ce projet raconte aussi ce choc intimiste épique : l’histoire réelle de cet adolescent qui rentre en collision avec cette ville, ce cirque Barnum, de bloc austère… Tout ce rapport d’instrumentation raconte cela aussi. J’aime jouer sur ce genre de contrastes, avoir un frottement entre quelque chose de très fragile et quelque chose de très linéaire, très froid. Je suis très inspiré par cette austérité : des choses quasi martiales, religieuses aussi, que l’on met en collision avec un son très orchestral, très cinématographique. Pour moi, cela signifie beaucoup de choses.
Il existe un petit livre – joliment illustré par Jillian Tamaki, talentueuse dessinatrice basée à Brooklyn – , un récit à quatre mains avec ta cousine Katarzyna Jerzak qui sert de fil rouge à ton « Golden Age », une trame mi-autobiographique, mi-fantasmée, à ton album… Peux-tu nous en dire plus ?
Ma cousine et moi, nous avons eu un parcours un peu similaire : on s’est, tous deux, arrachés à notre cocon familial pour réaliser quelque chose de plus grand. Elle est partie habiter aux Etats-Unis lorsqu’elle était très jeune, et elle est devenue professeur de littérature comparée à Princeton. Pour moi, c’était important d’écrire avec elle parce qu’on des valeurs communes sur l’arrache- ment, la famille, le rapport au passé. On a fusionné son passé et mon passé dans une sorte de récit, où l’on raconte l’histoire familiale, mais de manière très décousue. J’ai eu envie de faire ce projet, quasiment comme un exercice de psychanalyse, de manière très légère évidemment, même si le ton peut paraître souvent sérieux et solennel. J’y ai expulsé des fragments de visions, de chan- sons, de sonorités, d’éléments visuels que l’on peut retrouver morcelés dans les clips. Et je me suis rendu compte qu’en créant ces éléments les uns derrière les autres, j’arrivais à créer une histoire qui me racontait moi-même, parce que j’avais cette obsession de trouver instinctivement ces fragments-là au fond de moi. Ce récit n’est pas vraiment un roman, mais des fragments émotionnels qui racontent l’évolution d’un enfant qui grandit et qui devient un adulte.
Tu as écrit les chansons il y a plus de 2 ans, l’album est terminé depuis 1 an, quel est le recul que tu portes sur ton travail, aujourd’hui ?
Je dirais que cela a eu un effet thérapeutique dans une petite mesure. J’ai eu le temps de guérir de certaines blessures, de comprendre des choses, de répondre à des questions que je me posais et de faire un certain deuil. J’arrive, aussi, à avoir une certaine tendresse pour toutes les erreurs que j’ai pu commettre dans cet album, car il y en a. Il y a cette sorte de rébellion adolescente, où tu as envie de faire les choses un peu trop bien, un peu trop fort. Je me rends bien compte que je ne ferai plus jamais un premier album, et qu’il a tous les défauts et les qualités de la révolte adolescente. Aujourd’hui, je suis déjà ailleurs dans ma tête, mais cette thématique demeure très chère à mon cœur. Et ces chansons ne m’appartiennent déjà plus : elles sont prêtes à être véhiculées au public, et les gens vont les embrasser à leur gré, comme des titres d’héroïc fantasy ou de hipster !
Tu travailles beaucoup en post-production sur l’image, et ta musique, elle aussi, est très produite… Pourtant, tu tournes depuis pas mal de temps, et le concert quasi orchestral que tu as donné au Grand Rex a offert une autre dimension à ta musique. Comment conçois-tu le live et ton rapport avec le public ?
Je sais que ma musique est très nostalgique. J’ai, moi-même, beaucoup d’émotions lorsque je chante, mais quand tu es sur scène, tu ne vois pas si les gens pleurent ou pas. On voit uniquement si les gens bougent sur les titres plus dansants. Ce que j’aime, c’est que l’on pleure au début, et qu’à la fin, cela saute dans tous les sens ! Cela me plaît, parce que cela raconte le projet : cette transformation de ce personnage qui va d’un état très nostalgique à un état plus agressif et dynamique. Je choisis l’ordre des titres dans leur intention narrative, mais aussi leur intention sonore. Il n’y a rien de plus glorieux que de célébrer la réalité de la vie et des émotions : d’une faiblesse pour certains, je vois en cela une force. J’ai toujours trouvé inouïe, cette capacité qu’avait un groupe comme Depeche Mode à faire danser les gens avec de la musique triste. C’est la plus belle des musiques pour moi.
A un moment, tu as connu une sorte de rencontre artistique avec une artiste assez étonnante, pour laquelle tu as réalisé des clips, c’est Lana Del Rey. Peux-tu nous raconter cela ?
C’était plus qu’une relation artistique. Avec Lana, on a eu une rencontre presque amoureuse, on a été et on est toujours très proches. On s’est rencontrés à un moment où il nous arrivait un peu la même chose : le buzz du web s’était un peu emparé de notre musique. On s’est rencontrés à Londres. C’était avant la sortie de Video Game, on n’avait pas de budget, mais je voulais lui faire un clip sur cette démo piano-voix qu’était Born To Die à l’époque. C’est avec moi qu’elle a fait ses premières scènes, en commençant par NYC, et la suite on la connaît tous. Elle a dit, en interview au Grand Journal, que j’étais son âme sœur musicale, et c’est vrai. Et même musicalement, j’ai l’impression que l’on se retrouve beaucoup.
On peut dire, sans conteste, que jusqu’à aujourd’hui Woodkid a fait son petit bonhomme de chemin et qu’il possède la fameuse « Midas Touch ». Et quelque chose nous dit que ce n’est que le début. Ce n’est peut-être pas le cliché du golden boy auquel on pourrait s’attendre, mais il doit certainement avoir une pierre philosophale dans sa poche…
Woodkid, The Golden Age (Gum Records)
www.woodkid.com
Propos recueillis par Joss Danjean
Photos Matias Indjic
RéalisaTion Flora ZouTu
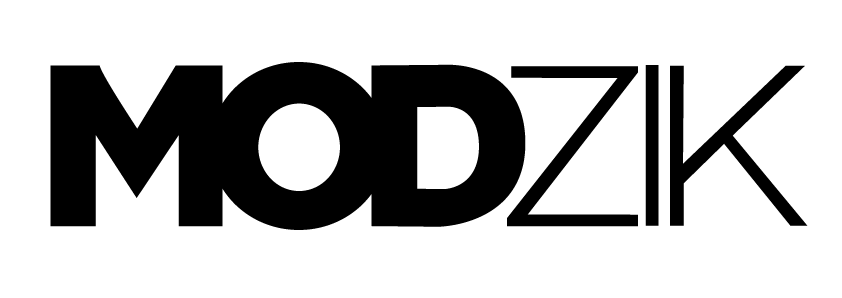




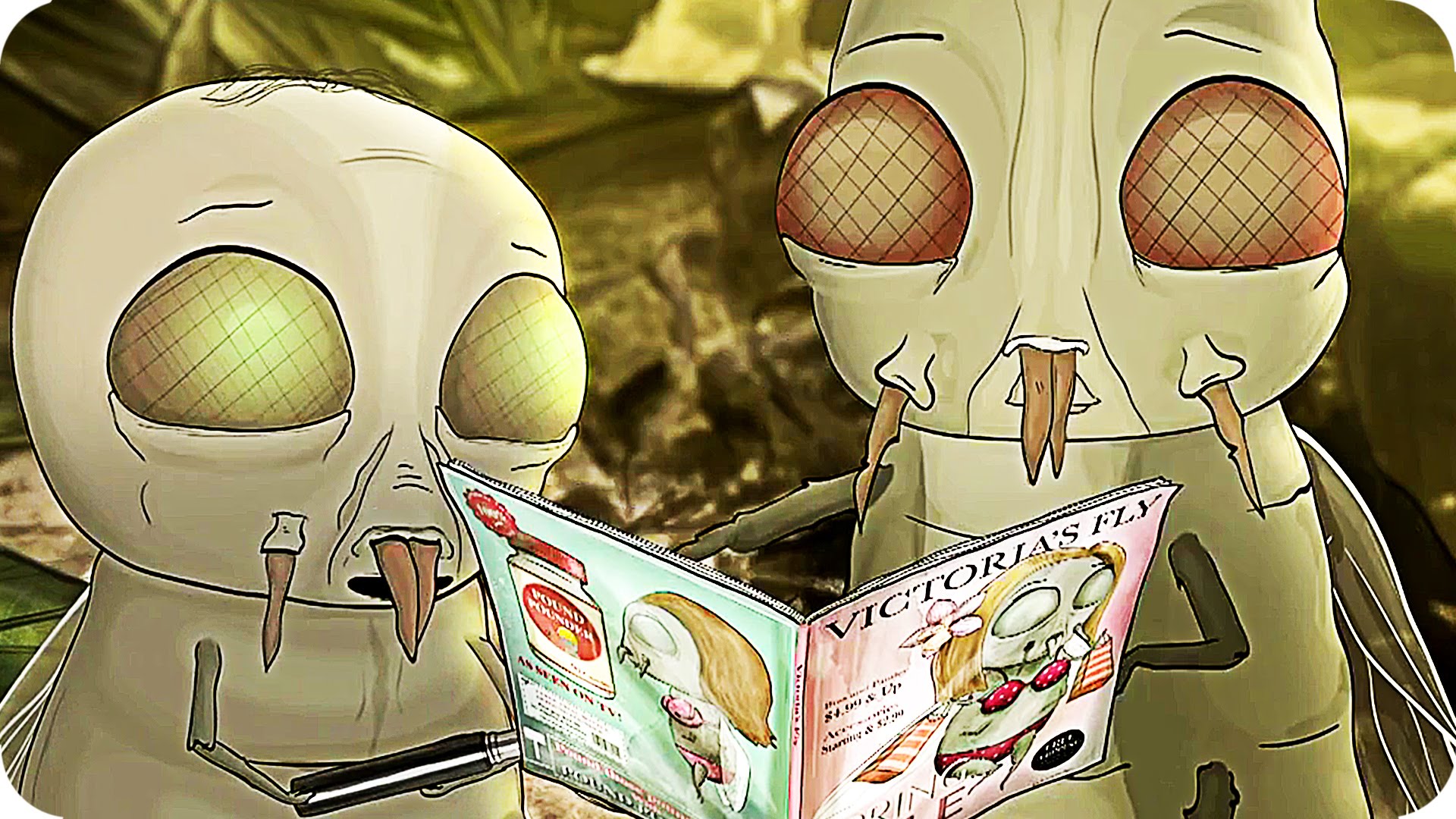






















31 comments
Comments are closed.