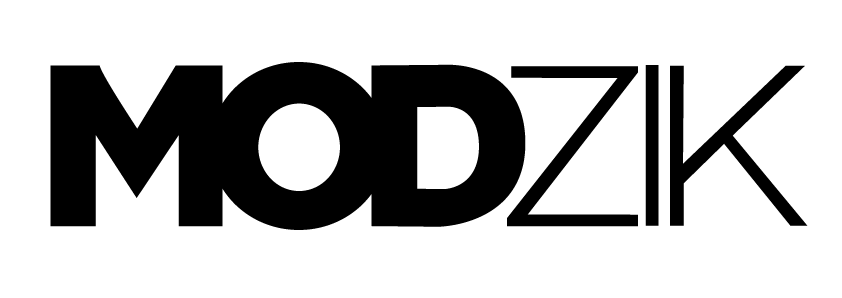Rappeurs sensibles adeptes de Martin Margiela et de pédicures : la nouvelle vague de rappeurs semble dessiner un nouvel horizon. Or, rien ne change : leurs productions sont toujours aussi machistes.
Il est partout. Il nous l’a bien montré cet été, son tube « Réseaux » tournant en boucle dans toutes les radios de l’hexagone. Son album Commando, a été sacré disque d’or seulement une semaine après sa sortie. Désormais disque de platine, il détient le record des meilleurs ventes en 2017. Sur son titre « Salé » – issu de cet opus – Niska, explore les revers de médaille de la gloire, sur fond de récit autobiographique teinté d’ego trip. Les femmes, font parties intégrante de cette histoire. Sans voix, elles sont avant tout évoquées comme de simples objets sexuels, sales — « la chatte de la petite est sale » — et prostitués (« elle peut s’acheter des fringues, elle bosse chez nous sur viva street »). Ce discours n’est pas sans rappeler « Mwaka Moon » — titre de l’album éponyme paru cette année —, où Kalash est en featuring avec Damso. En effet, le rappeur belge ne demeure pas différent de ses confrères quant à l’objectification des figures féminines : il « nique des mères pour la dînette » et ordonne à « une grosse salope », de se mettre à « quatre pattes sur le bitume ». De plus, sa vision de la sexualité présente la femme comme l’inégale de l’homme au sujet de l’adultère : « s’faire sucer, c’est pas tromper ». Vision aussi existante dans « Macarena », où Damso se fend d’un : « tu baises avec moi tu baises avec d’autres, même si j’fais pareil, c’est pas la même chose » qu’il justifie par son besoin de libido. Bien que cela soit le reflet de son ego blessé, cette phrase s’inscrit dans une rhétorique machiste. Par ailleurs, si la femme-objet est omniprésente dans le rap game — Kaaris, par exemple, vient « pour arroser ces chiennes comme une douche italienne » sur le morceau « Dozo »— elle sert aussi de faire-valoir au rappeur parvenu. C’est ainsi que SCH donne à voir l’étendue de sa richesse lorsqu’il dit que sa conquête ne prend pas de heetch (« Mac 11 »). Cet aspect est cristallisé par la chanson « Ce soir on ne sort pas », où Maître Gims donne la réplique à Lacrim. L’ancien membre de Sexion d’Assaut lance à un destinataire inconnu un « t’es même pas michtonnable ». Signe que le respect accordé dépend de la capacité à attirer les michtonneuses.
À l’heure où les coming-out de rappeurs se font nombreux (outre-Atlantique surtout), où le style vestimentaire s’éloigne des codes virilistes et les textes font la part-belle au lyrisme, pourquoi le slut-shaming demeure, alors qu’on pourrait croire à une déconstruction des normes genrées et sexuées ? L’archétype féminin cité reste le même : une fille facile, soumise, dévaluée et uniquement attirée par l’argent. Effectivement, l’habit ne fait pas le moine : « Je ne pense pas qu’il y ait un lien entre le style des rappeurs et leurs discours sur les femmes. Ce n’est pas parce qu’on a les cheveux lisses ou qu’on porte un chino qu’on se transforme automatiquement en fervent défenseur de la condition des femmes », dixit Louise Wessbecher, journaliste à Mashable et France 24. Évidemment, il ne s’agit pas là d’un problème limité au rap, mais à la place qu’occupe une certaine idée de la virilité houleuse dans l’inconscient collectif, tout particulièrement dans les milieux artistiques. N’oublions donc pas de rappeler que, Bertrand Cantat faisait la Une des Inrocks, Roman Polanski s’affichait sur la couverture de Citizen K et « Mother ! », de Darren Aronofsky, traitait du besoin de soumission totale d’une femme face à un génie masculin.
Comme le montre un nombre grandissant de chercheuses et journalistes dont Eloïse Bouton — auteure du site Madame Rap —, la société a tendance à montrer du doigt les rappeurs comme s’ils étaient à l’origine du sexisme de la société, pour leur en faire porter la responsabilité actuelle – alors que la figure du bordel, du maquereau, du Don Juan ou de la Parvenue, sont des mythes inhérents à notre monde et déclinés à chaque époque selon le milieu culturel. Le hip-hop, lui, ne fait que cristalliser les désirs et les stigmates d’une époque. Comme le souligne Sarah Francesconi, journaliste à Maze Magazine, « les textes de Damso ont aussi beaucoup fait parler par rapport à cette question de la représentation de la femme. Mais quand on lui pose la question, il répond « c’est pas Damso, c’est tout le monde » (dans Quotidien par exemple), suggérant qu’il met en mot ce que personne n’ose prononcer mais pense de plus belle. Elle ajoute également que, malheureusement, les rappeurs aujourd’hui attisent la plus grande attention lors de violences faites aux femmes et d’altercations avec la justice : force est de constater que des figures engagées comme Kery James n’attisent pas autant les foules mainstream et mode que des artistes hip-hop poussés dans des clichés obsolètes.
De plus, une scène grandissante féminine reste largement sous-representée, si elle-même ne rentre pas dans des clichés en miroir : « le problème ne vient pas tant des textes eux-mêmes sinon de la sous-représentation médiatique dont sont victimes les rappeuses (…) donnant cette impression de déséquilibre des reflets des désirs féminins et masculins » , ajoute Sarah Francesconi, en citant Princess Nokia ou Shay.

Pourquoi le rap déborde-t-il encore de slutshaming ? Car s’il se fait l’image et non l’instigateur de violences, il narre une ère dominée par le harcèlement quasi-quotidien fait aux femmes, un monde où Harvey Weinstein, Woody Allen (et j’en passe) ont connus des gloires rayonnantes malgré des accusations avérées. Blâmer le hip-hop – en renforçant la figure du sauvage hypra-sexuel – ne fait qu’ignorer un problème plus large d’un patriarcat sans cesse starifié et remis à jour. Ésperons que le mouvement #MeToo encouragera un nombre grandissant d’hommes à devenir des alliés et à refuser les clichés.