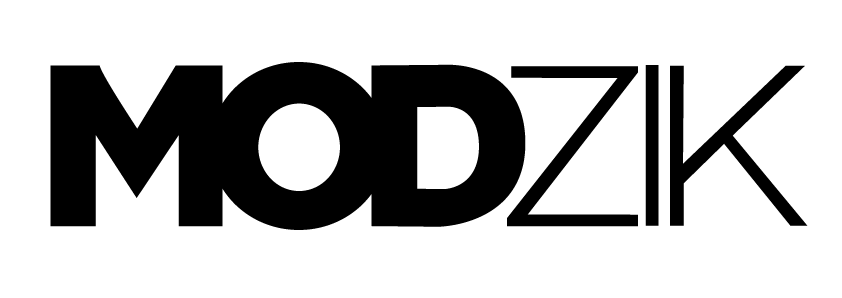/
Amoureux des couleurs franches, Jean-Michel Cazabat a marqué la scène new-yorkaise avec ses « happy shoes » aux souliers sensuels, joyeux et confortables.
De Scarlett Johansson à Bella Hadid en passant par Lenny Kravitz, ses créations ont séduit les plus grandes icônes. Il signe aujourd’hui son retour à Paris avec une version renouvelée de sa marque, simplement baptisée Cazabat : une collection qui célèbre le style et les couleurs, avec des chaussures pensées pour sublimer les femmes sans jamais les faire souffrir.
Vous avez créé votre marque à New York. Est-ce que vous y êtes arrivé avec ce rêve-là en tête ?
Pas du tout. À l’origine, je suis arrivé aux États-Unis en 1985 pour développer une marque qui s’appelait Stéphane Kélian. Á l’époque, la boîte cartonnait partout dans le monde, elle était même cotée en bourse, mais elle ne marchait pas du tout aux States. Et moi, j’étais censé venir juste pour une semaine. Après, Stéphane m’a demandé ce que je pensais du business ici et si je voulais m’installer. Moi, qui viens du Sud-Ouest de la France, j’avais deux rêves : Paris et New York. Je lui ai dit que je lui donnerais une réponse le lendemain et au final je suis resté dix ans ! Je me suis occupé du wholesale international et de deux magasins. Puis Stéphane a décidé de vendre, à cause de la pression de la bourse. Il m’a dit que si on me proposait autre chose, il fallait que je le prenne, même si lui n’aurait jamais imaginé se séparer de moi. C’était le moment pour lui de clôturer ce chapitre.
Et après cela, quel était votre plan ?
Je n’en avais pas. Seulement un soir, on est allé à un dîner avec un de ses amis coréens, qui était aussi un copain de Charles Jourdan. Et une chose en amenant une autre j’ai commencé à bosser chez Jourdan dans la chaussure. J’y ai été directeur artistique pendant deux ans, puis j’ai ressenti le besoin d’indépendance et de m’affranchir des codes des grands groupes. Je me suis dit qu’il était temps de créer ma marque. J’ai lancé ma petite marque avec seulement trois modèles. J’avais peu de moyen donc j’ai choisis de n’avoir qu’un seul matériau : l’imprimé serpent. En fait j’adore, surtout le python. Je l’avais décliné en rouge, bleu, turquoise, vert, jaune, noir… Je faisais des salons comme Coterie, l’équivalent de Première Classe ici à Paris. Les gens passaient devant mon stand en se moquant (gentiment) de moi et de mon obsession pour le python. Et puis il y a eu le défilé Tom Ford pour Gucci, où il a sorti une collection blindée d’imprimé serpent. Le lendemain matin, dans WWD, le titre c’était : « The Year of the Snake ». Les deux derniers jours du salon, les gens faisaient la queue devant mon stand. Tom Ford venait de me conforté dans mon choix.
D’où venez-vous et quelles inspirations avez-vous incorporées à votre vision aujourd’hui ?
D’une ville appelée Tarbes, au pied des Pyrénées. Concernant mes inspiration elles viennent beaucoup des années 70 et 80 et de la musique. J’aime tout ce qui est festif. Je ne veux pas créer des chaussures tristes, mais qui vivent, qui ont de l’énergie, de la couleur, du peps. Je refuse d’être comme les créateurs belges ou japonais qui font toujours du blanc ou du noir.
/
/
Si vos chaussures pouvaient parler, quelles histoires raconteraient-elles ?
Ce seraient toujours des histoires joyeuses. Une chouette histoire, c’est le défilé l’Oréal en septembre dernier. Après qu’on ait lancé notre Instagram, des stylistes du défilé nous ont contactés. Ils ont fait une énorme sélection de nos chaussures pour les fittings, parce qu’il y avait 35 égéries qui défilaient, et on a envoyé tout ce qu’ils voulaient. Au début, on était sceptiques, on se disait qu’il y aurait peut-être deux ou trois looks avec nos chaussures. Et en fait, on s’est retrouvés sur 70 % des looks. On était au premier rang, on était choqués. La marque venait juste de se relancer, on n’avait même pas encore de boutique ni de site, et cette expérience, ça a boosté notre confiance. On était au bon endroit, et c’est parti !
Qui est la personne que vous rêviez de chausser ?
Bianca Jagger. Et je l’ai fait. Je l’ai rencontrée via des amis à New York. Renée Cox m’invite en Jamaique au premier Noël après le 11 septembre. La plupart des gens n’osaient pas voyager, donc ses connaissances avaient loué une maison à Port Antonio, en Jamaïque, d’où Renée est originaire. On s’est retrouvés dans un endroit où il n’y avait que six maisons, toutes louées. Il y avait le prince Habsbourg, Bianca Jagger, Grace Coddington du magazine Vogue… Durant le soir du 31 décembre, je dansais avec une fille, puis à un moment je vais m’asseoir tout transpirant pour boire un verre, et les gens me disent « Alors, elle te plaît, la petite ? ». Tout le monde l’appelait « la Latina » et on me dit qu’elle est fiancée à un joueur de foot. C’était Shakira. Et je ne l’avais pas reconnue en même temps, pas maquillée un 31 décembre en pleine Jamaïque. Puis, dans cet endroit, tout le monde faisait à tour de rôle des repas, des barbecues. Et là, je vois une chaise vide à côté de Bianca, et je me dis : « c’est mon moment ». Je lui demande « May I sit ? », elle me dit oui. Et je lui dis : « Bianca, I’m so happy to meet you. When I was a child, it was always the dream of the ultimate beauty ». Et moi, vu que j’avais bien ouvert la marche en cuisine, les familles m’ont engagé pour cuisiner chez eux. Je le faisais complètement défoncé, parce que les mamans jamaïcaines me faisaient fumer des gros joints avec toujours plus de rhum ! Et la première personne que je servais à chaque fois, c’était elle.
Et alors comment avez vous réussi à la chausser ?
On s’est recroisés dans un restaurant appelé Le Cirque et elle m’a demandé pourquoi je n’étais pas venu à la fête qu’elle avait organisée deux jours plus tôt. Je lui ai dit que je venais juste de rentrer, et à ce moment-là elle savait que j’étais chausseur. C’est comme ça que j’ai réussi à chausser Bianca Jagger. Et la dernière fois que je l’ai vue, c’est ici même, à l’hôtel Costa. J’ai eu la chance de chausser Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Sarah Jessica Parker, Taylor Swift, Blake Lively, Solange Knowles, Lenny Kravitz…
Madonna ? On veut l’histoire…
Je faisais un salon à Los Angeles pour présenter ma collection. Une dame super sympa arrive et me dit : « Puis-je faire une commande ? ». Je lui dis : « Bien sûr », et là elle commence à pointer cinq paires de chaussures et les demande en taille 38. Je lui dis qu’on ne fait pas de commande comme ça, que c’est à partir de 12 paires. Et là, elle se présente : « Je suis Arianne Phillips, la styliste de Madonna ».
//

//
Quel est votre premier grand succès ?
Ma toute première collection. Ma première mule avec le bandeau en imprimé python. J’avais fait toutes les semelles intérieures rouges. C’est dommage parce que j’avais plein de photos de l’époque dans des CD que j’ai perdu pendant le déménagement. Sinon je peux te faire un croquis !
//

/
Quelle est votre dernière grande réussite ?
Remonter Cazabat avec Daphné. Il y a aussi eu l’ouverture du corner au Printemps. Même si c’est plus utile en termes d’image que commercialement on est très contents. Et puis il y a l’ouverture d’une nouvelle boutique à la fin de cet été.
/

/
Sans qui n’en seriez-vous pas là ?
J’aurais pu dire Johnny Hallyday. Quand j’avais 12 ans, j’étais obsédé par la photo, la musique rock, les chaussures et les cheveux. Mon oncle et ma tante m’ont emmené à un de ses concerts et j’étais là avec mon Instamatic, en train de faire des photos de lui, émerveillé. Je me suis dit : « OK, je veux être photographe ». Mon grand-père m’a alors acheté un Canon. J’ai acheté un agrandisseur pour imprimer moi-même les photos, puis j’ai fait l’École nationale de photographie. Après mon service militaire, je voulais juste me casser à Paris et je l’ai fait. C’est peut-être la photo qui m’a mené à la chaussure. Je rêvais d’être l’assistant d’Helmut Newton ou de Guy Bourdin. C’est beau de rêver mais j’avais besoin d’un job, et c’est grâce à un copain que j’ai bossé chez Charles Jourdan.
Où avez-vous affiné l’art du glamour ?
D’abord, il faut que la personne se sente séduite dans ses souliers, car si elle est séduite, elle peut séduire la terre entière. Il ne faut pas qu’elle ait de doutes. Mon idée du glamour, celui que je crée, est coloré, très glitter, assez théâtral. C’est un truc avec de la vie.
Qu’est-ce qui rend la marque 100 % reconnaissable ?
Le confort et les couleurs. Ce sont des « happy shoes », parce que dès qu’une femme les met, même si c’est un talon de 10, quand elle se lève, elle sourit, car c’est confortable. J’aime trop les femmes pour les faire souffrir. Et de toute façon, fais souffrir une femme et tu paieras dix fois le prix. Nos chaussures sont faites pour courir tous les moments de la journée d’une femme, à n’importe quelle saison.
/
/
Sur quel album aimeriez-vous danser toute la nuit ?
C’est dingue, la plupart des albums que j’aime ne sont pas pour danser. Mais alors, ce serait de la musique funk. J’aime le funk et le disco. Les années 70, c’était fabuleux. Ce serait un album de Gladys Knight & The Pips, par exemple.
Laquelle de vos chaussures choisiriez vous pour cette nuit de folie ?
Des boots comme celles-là. J’aime toujours avoir un petit talon, je n’aime pas être à plat c’est comme si je n’avais pas d’élan. D’ailleurs ces bottes, je les avais créées à l’époque pour Lenny Kravitz. Elles sont en python naturel de Rochard j’en ai fais d’autres déclinaisons.
/

/
Qu’est-ce qu’il manque à Cazabat pour aller encore plus loin ?
Je dirais le côté international. Le footprint, l’empreinte géographique. Et un peu plus de force de frappe en communication. Pour l’instant, on est une marque assez confidentielle. Elle s’est lancée à une époque où les codes n’étaient pas du tout les mêmes qu’aujourd’hui. C’était plus facile de croître organiquement, et c’est ce que j’ai fait grâce à mon réseau et à mon bagou. Aujourd’hui, tu as besoin d’une communication forte. Il faut que les gens rentrent en contact et connectent avec notre chaussure. On a un vrai savoir-faire, on est une marque de chausseurs. Notre côté traditionnel, confortable et qualitatif est important pour nous. On a nos usines en Italie. On a le savoir-faire, mais il nous manque le « faire-savoir » (rire). Et l’idée, c’est d’avoir quand même, je dirais, 60 à 70 % de la collection composée de piliers qu’on reconduit d’une saison à l’autre. Et de ne pas faire des collections ultra-denses, ultra-diffuses afin de garder notre identité.
/


Sur quelle chanson aimeriez-vous voir vos chaussures danser ?
You Can Do It de Hudson & The Partners.
Quel conseil donneriez-vous à ceux qui ont abandonné leurs rêves ?
Mais il ne faut jamais abandonner un rêve. Même si tu prends des claques et que c’est dur, tu dois t’accrocher. Sinon, tu auras toujours ce regret au fond de toi. On m’appelait « The Cat with Nine Lives » ou le « Firebird » parce que quoi qu’il arrive, j’allais trouver un moyen de me relever, de renaître de mes cendres. J’en ai eu souvent des flops faut juste remonter.

Texte Noémie Fonkou Guemo