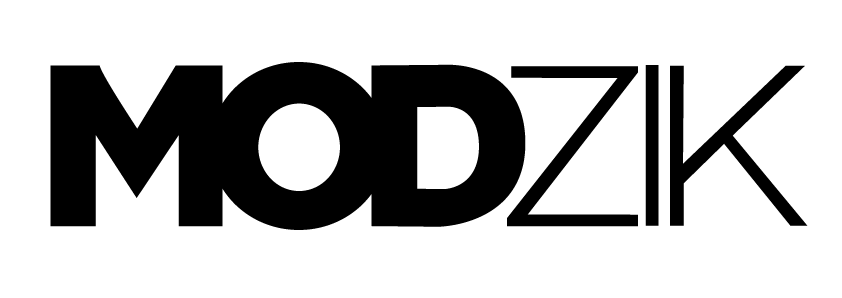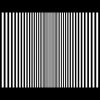On pourrait parler des heures, des jours du pouvoir et des jeux de pouvoir de la mode. À l’heure d’une prétendue démocratisation d’un milieu longtemps réputé comme inaccessible et secoué par de nombreux changements, rencontre avec trois icônes de la sphère mode : Sophie Fontanel, Loïc Prigent et Alice Pfeiffer. Aujourd’hui, c’est l’interview de cette dernière que l’on vous propose de découvrir. Journaliste aussi à l’aise sur les gender studies que sur l’historique du survêt, on retrouve son regard plus qu’avisé sur la mode et son monde si particulier dans les Inrocks, The Guardian ou encore Antidote, dont elle est depuis peu rédactrice en chef. Une rencontre où se croisent Aaliyah, les réseaux sociaux et le pouvoir d’une mode 2.0.
Entretien et illustration : Safia Bahmed-Schwartz
Salut Alice, tu peux te présenter ?
Je m’appelle Alice Fantastique Pfeiffer, j’ai 31 ans et demi. Je suis journaliste, je fais très bien la danse du ventre et je vis à Montreuil.
Comment en es-tu venue à faire du journalisme ?
J’aimais beaucoup l’anthropologie et les cultural studies, mais la vie purement académique m’angoissait. J’ai une maman sociologue qui passe beaucoup de temps sur des projets très longs. J’ai besoin de produire plus rapidement, de voir des gens et leur parler, évoluer en société et non dans une bibliothèque…
Et pourquoi la mode ?
Je veux rendre ses lettres de noblesse à ce qui a été rejeté par les grandes sciences. Dans le milieu universitaire français, il y a un vrai snobisme autour de la culture populaire. Aux États-Unis, Beyoncé est en couverture du Time, Taylor Swift est prise aux sérieux, les Kardashian font la une de Vogue. Nous, on ne s’intéresse pas à nos propres célébrités. Sinon, on aurait vu Valérie Trierweiler et Julie Gayet en couverture de Vanity Fair.
Tu aurais pu choisir un autre sujet ?
Quand j’ai commencé le journalisme, on m’a dit « l’art contemporain, c’est bien, la mode, c’est de la merde », mais la mode ne se limite aux bourgeois qui parle de choses bourgeoises. On peut écrire tout aussi magnifiquement sur une paire de Cortez que sur une œuvre de Jeff Koons. On peut écrire un poème sur des joggings, qui pour moi sont plus révélateurs que ce qui se passe dans le milieu de l’art qui ne touche qu’un fragment de la population.
La mode c’est quoi pour toi ?
C’est le rôle du vêtement dans la société qui m’intéresse. Que ce soit le costume religieux – que je trouve fascinant – et ses détournements, les perruques chez les orthodoxes qui sont dingues, le costume scolaire…
Alors le vêtement, ça représente quoi ?
Ce qui est formidable avec le vêtement c’est qu’il a un vrai pouvoir de transformation. C’est un vrai passeport social. Aujourd’hui, Iris Apfel fait encore carrière grâce à son look et les vêtements, c’est la moitié du discours de certains rappeurs. C’est une enveloppe que tu choisis et que tu contrôles.
Quelle importance ont pour toi les mots ?
Ça ne m’intéresse pas de dire « c’est moche » ou « c’est beau ». Il y a un effet visuel premier, quelque chose claque ou pas. On a tous des souvenirs de coups de cœur visuels, pour moi c’est Aaliyah dans la pub Tommy Hilfiger. Je la trouvais tellement chic avec son slip assorti à son soutien-gorge et il n’y avait pas besoin de m’expliquer ce que ça racontait.
Pourquoi écrire sur la mode alors ?
J’aime réfléchir à son impact social : pourquoi c’est important d’avoir Aaliyah dans une campagne Tommy Hilfiger ? Qu’est-ce que cela signifie pour l’image de la marque ? Réaliser qu’à cette époque, c’était la preuve d’une évolution. C’est compliqué que le voile soit illégal en France alors qu’en Angleterre, Uniqlo fait des hijabs. Il faut parler du pouvoir politique du vêtement sinon ce n’est qu’une histoire visuelle.
C’est un vrai travail de documentation ?
On document l’histoire de l’art, mais pas l’histoire du port de la basket, du port des lacets. Quand j’étais petite, on les cachait. Ça n’a pas été documenté parce que les gens trouvaient ça sans importance. La France reconnaît la Haute couture, le luxe, mais aucun bouquin ne documente l’histoire du vêtement de kaïra des années 90. Je trouve ça dommage.
Quel est ton rapport aux réseaux sociaux ? Quels sont ceux que tu utilises ?
J’utilise Instagram, Snapchat, Facebook. Ce qui est malin avec Instagram, c’est que le principe découle du journalisme : tu as une photo et une légende. Consciemment ou inconsciemment, on raconte quelque chose sur soi, on est libre, on est observé et bizarrement c’est là qu’on trouve le plus de cohérence. Il y a un discours symbolique de notre époque qui se trace au travers de milliards d’images trouvées, reprises, fabriquées. La création aujourd’hui c’est donner un nouveau contexte à quelque chose d’existant.
As-tu conscience de ton pouvoir ?
À partir du moment où tu es lu, tu as une responsabilité vis a vis des journaux pour lesquels tu écris. Tu ne parles pas qu’à tes amis. Tu penses au politiquement correct, tu soutiens.
C’est quoi le pouvoir de la mode aujourd’hui pour toi ?
Il est lié aux réseaux sociaux. On est sorti d’un schéma pyramidale du désir ou seulement les très grands ont de l’influence. Des filles inconnues au bataillon ont des millions de followers parce qu’elles ont réussi à créer une image cohérente. Tout le monde peut tricher.
Tu penses que les réseaux sociaux font évoluer la mode ?
La mise en scène 2.0 a permis une égalité dans l’image. Tout est dématéralisé, tu fais ce que tu veux, ça unit les gens. Le mannequinat c’est un des seuls endroits avec une vraie fluidité sociale : si tu es bonnasse, peu importe d’où tu viens. Il y a la fascination de la belle plante, mais aussi du cracra. C’est moins caviar-champagne qu’à une époque.
Un mot sur Snapchat ?
C’est une fenêtre sur l’intimité des gens. Les gens livestream leur vie, c’est fou. Il y a aussi ceux qui sont super talentueux et tirent profit de cet outil pour être au top de leur créativité.
_