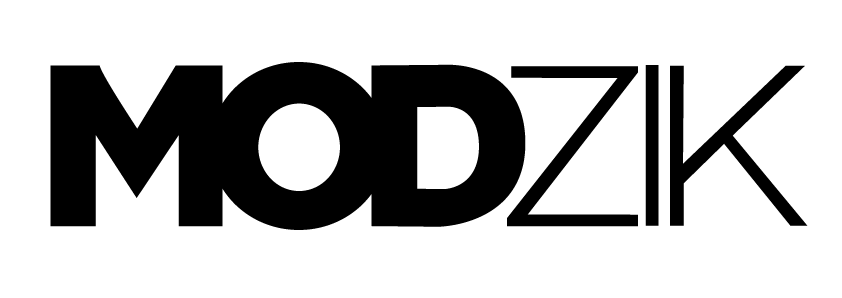Avec Unfurl, son huitième album, Asaf Avidan signe une œuvre cinématographique et introspective, mêlant orchestre symphonique, accents jazz et fulgurances rap, pour explorer la dissolution du moi et la beauté trouble de l’inconscient.
/
/
Enregistré aux studios Miraval avec un orchestre de quarante musiciens, mêle arrangements symphoniques, jazz et rap pour créer une ambiance cinématographique à la Hitchcock. Asaf Avidan y explore la dissolution du moi à travers des textes introspectifs et des atmosphères contrastées, entre lumière et ombre, conscience et inconscient. Un voyage intérieur où vulnérabilité, émerveillement et inquiétude s’entrelacent pour révéler une quête universelle de sens.
/
Le mot Unfurl évoque à la fois la vulnérabilité et la libération. Qu’est-ce que vous vous êtes senti prêt à laisser s’ouvrir en vous au moment de commencer cet album ?
Unfurl parle de vulnérabilité mais aussi de l’espoir qui accompagne le fait de s’étendre, de s’ouvrir vers l’extérieur. Je vis maintenant dans le sud-ouest de la France, dans une belle propriété près d’une rivière. Et près de la rivière poussent des fougères. Quand j’y marche tous les jours avec mes chiens, on peut presque voir en stop motion : le premier jour ce n’est qu’une petite spirale poilue, un petit rejeton qui émerge dans le monde. Et lentement il commence à se déployer vers l’extérieur. Il y a cette fragilité, mais aussi le courage d’un être qui s’ouvre avec espoir. Et ce n’est pas que de l’espoir. Quel est le mot… ? Un certain désespoir. Parce que ce qu’elle cherche, c’est la lumière du soleil : elle doit s’étendre vers le monde pour survivre, mais cette extension vers l’extérieur la met aussi en danger. J’ai trouvé cela beau et poétique. Et l’album, l’expérience de l’album, est un peu différente parce que le déploiement est vers l’extérieur, mais aussi vers l’intérieur. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai toujours l’habitude de m’excaver moi-même. C’est la seule chose que je sais faire. Couche après couche, avec des outils grossiers, je vais à l’intérieur et je cherche ce qui se trouve dans la psyché, dans l’inconscient, appelez-le comme vous voulez. Et j’essaie d’en extraire quelque chose. Dans mon album précédent, Anagnorisis, je suis vraiment tombé dans un terrier de lapin. Ça sonne métaphorique, mais c’était presque viscéral comme sensation. Plus j’excavais, plus je pensais atteindre une pépite de vérité. Puis, dans l’album précédent, je suis tombé dans un abîme, un nuage du moi. Au début j’avais très peur, je me disais que ce ne pouvait pas être vrai, que je ne regardais probablement pas assez bien. Puis j’ai compris que c’est la réalité fondamentale, bouillonnante, d’être un être conscient et subconscient. J’ai traversé ça, et quelque chose dans la membrane entre l’inconscient et la conscience s’est comme évaporé, s’est amincie. Et j’ai eu la sensation de tomber vers l’intérieur : une spirale de vertige, tomber vers un moi qui n’existe pas, vers une multitude de cellules, vers un flux d’infini. Le moi se dissolvait. Je sais que ça paraît fou, mais si vous lisez Freud ou Jung, ou des textes psychanalytiques, ou bien des textes religieux anciens d’Orient sur les états méditatifs du nirvana où l’on lâche le moi dans l’univers, enfin peu importe. Je ne suis pas une personne spirituelle ni religieuse, mais c’était presque une noyade spirituelle/psychologique dans l’abîme de moi-même. C’est ce que j’ai ressenti. Et c’est ce que l’album tente de dépeindre : cette sorte d’émerveillement, de beauté et d’admiration, mais aussi la panique qui l’accompagne. L’album est donc toujours ce genre de dialogue étrange. Freud appellerait ça l’ego et l’id (le ça en français), Jung parlerait du conscient et de l’inconscient, quelqu’un d’autre dirait l’infini et le moi. Peu importe la sémantique ; il s’agit de cette expérience. Donc le déploiement est à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur.
/

/
Unfurl s’inscrit-il dans la continuité de l’album précédent ?
Oui, d’ailleurs chacun de mes albums est une continuité directe. Mon premier EP s’appelait Now That You’re Leaving, c’était du genre « je la blâme pour tout maintenant que tu pars ». Six chansons sur une relation, très classique, mon premier plongeon dans la musique. Puis mon premier LP, The Reckoning, parlait d’un face-à-face avec soi-même, de commencer à prendre la responsabilité de ces émotions et de ces relations qui ne fonctionnaient pas. C’était encore très « il a dit / elle a dit ». Ensuite chaque album qui a suivi est venu ajouter une couche. C’est tout le même chemin. La recherche du moi qui traverse un album mute lentement pour le suivant. Donc oui, je suis tout à fait d’accord.
Unfurl est né d’un journal de rêves, peu à peu transformé en ce que vous décrivez comme un « cauchemar jungien ». À quel moment avez-vous compris qu’un album était en train de naître de ce processus ?
Je ne sais jamais quand un album est là – je sais toujours quand il existe, mais je ne sais jamais comment y parvenir. Je crois que quand mon existence devient trop insupportable, la musique est ce que j’ai développé ces vingt dernières années pour la rendre un peu plus supportable. Je comprends qu’un album existe quand je ne peux plus respirer sans lui, quand ce cauchemar jungien devient trop présent. Ce que j’essaie d’expliquer, c’est que je ressentais toutes ces choses depuis que j’ai fait l’album précédent : cette chute dans l’abîme, la perte du moi. Je me sentais flou. Je me surprenais à fixer une plante pendant je ne sais combien de temps, comme des gens qui ont fait un mauvais trip au LSD et qui ne reviennent jamais tout à fait. J’avais l’impression d’avoir fait un pas de trop ; je savais que ce ressenti existait mais je ne savais pas comment l’exprimer, car c’est une sensation nébuleuse : comment décrire une nébuleuse, un nuage qui a une structure ? C’est impossible. J’ai donc commencé toutes sortes d’exercices. Je ne voulais pas recourir à des drogues dures pour revisiter cet état, c’était trop dangereux. J’ai beaucoup lu Jung ; il pratiquait des expérimentations de méditation auto-guidée qui ne sont pas vraiment du rêve lucide, ce n’est pas un état de rêve mais quelque chose entre l’éveil et l’inconscient. Ce sont des exercices, presque des méditations, mais plutôt de l’imagination guidée – une imagination auto-guidée. J’ai essayé le journal de rêves, mais rien ne fonctionnait. Ce que cela a fait, en revanche, c’est rendre la membrane encore plus poreuse : tout devenait trop, j’avais l’impression de ne plus pouvoir être moi-même, parce qu’il y avait trop de choses. Il y a un remous constant en arrière-plan que j’écoute, et une petite partie de mon cerveau me dit sans cesse « oh, il y a quelque chose là-dedans ». Puis, je ne sais pourquoi, c’est une longue histoire, je suis allé aux studios Miraval, sur la propriété de Brad Pitt. Ils m’ont invité en résidence, disons en retraite d’écriture. Ils m’ont hébergé ; Brad Pitt est venu à un concert et il a beaucoup aimé. Il m’a invité ; je me suis dit que jamais je n’aurais de nouvelles. Je connais les stars d’Hollywood. Puis nous avons reçu un mail de son assistant disant « Vous devriez absolument venir ». Je suis donc allé là-bas. J’étais complètement seul. Après cinq années à tenter d’écrire ce sentiment sans y parvenir, dans cet état poreux, cette rupture entre des états, je me suis assis dans cette villa perdue au milieu de nulle part ; il y avait une tempête dehors, c’était comme un plateau de cinéma. J’étais seul dans un endroit que je n’avais jamais visité. Complètement dans le noir, j’ai pris ma guitare. Et je ne sais pas pourquoi, seuls les dieux de la musique le savent, pendant cette semaine, les quatre premières chansons de l’album sont sorties. Et soudain je me suis dit « Attends ». Et quand on l’a, on se demande pourquoi on a essayé pendant cinq ans sans y parvenir. Je ne sais pas. Leonard Cohen a dit dans une interview : « Si je savais d’où viennent les chansons, j’irais plus souvent ».
Le single Unfurling Dream donne le ton de tout l’album. Pourquoi l’avoir choisi pour ouvrir le disque, et qu’aimeriez-vous que les auditeurs perçoivent d’Unfurl dès cette première écoute ?
Je pense que Unfurling Dream, et une autre chanson intitulée I Don’t Know When, I Don’t Know How, I Don’t Know Why, sont les deux morceaux qui, si je devais définir l’album, le feraient. Elles contiennent tout le parcours cinématographique. Elles comportent des couplets rap, que je ne pratique habituellement pas, mais j’avais beaucoup de textes paniqués, et pour une raison quelconque cela s’est imposé sans vraiment être un choix. Elles rassemblent tous les éléments, thématiquement et esthétiquement, qui, selon moi, constituent l’album. Quand je suis revenu de Miraval avec ces quatre chansons, je me suis dit « D’accord, j’ai un album ». J’en ai parlé à ma compagne : « Je crois que j’ai le commencement de quelque chose, écoute ». Mais ce n’était que moi et ma guitare ; je sentais qu’il me manquait la langue. J’avais le thème, les mélodies, mais que me manquait-il ? Nous avons regardé un film d’Hitchcock ce soir-là : Vertigo. Il comporte un magnifique thème de Bernard Herrmann, le compositeur des films d’Hitchcock, et ce thème sonne vraiment comme une spirale. Puis soudain des cuivres arrivent : riche, effrayant, étrange. Je me suis dit « Voilà ». J’ai couru dans mon studio, ouvert un clavier, ajouté des sons de cordes pour composer. Et soudain tout s’éclairait : le cinéma devenait le langage qui expliquait et projetait ce monde subconscient. Presque comme un film de David Lynch : les choses sont étranges, inquiétantes, c’est moi mais ce n’est pas moi. J’ai imaginé tout un monde visuel, déjà amorcé auparavant, inspiré des thrillers psychologiques des années 40-50 à la Hitchcock, où mon subconscient est projeté comme un film. J’en suis l’acteur, et parfois je suis en dehors. Suis-je l’acteur ? Le personnage ? Tous les personnages sont-ils moi ? Suis-je en rêve ? Ne le suis-je pas ? C’était une décision visuelle étrange, je ne sais pas. C’est visible sur la pochette : elle ressemble à une affiche des années 50 de ces films. On le retrouve dans les vidéos, dans ma manière de m’habiller sur scène et partout. C’est évidemment présent dans la musique : celle-ci est fortement influencée par ces films. Bernard Herrmann, et aussi John Barry, le compositeur des grands thèmes de James Bond. J’adore la richesse de cet univers : des orchestres complets, mêlés parfois à une formation jazz, avec ce beau mélange de genres. C’était mon rêve et nous l’avons réalisé : nous sommes allés enregistrer avec un orchestre symphonique en live. C’est tout un package. Je pense que la vidéo dépeint toute cette étrangeté, cette peur, cet absurde, l’inquiétante étrangeté du monde onirique, qui peut parfois sembler plus réel que le monde réel.
/
/
Cet album puise dans des sources inattendues : jazz, folk, rap et musiques de film vintage. Quel a été le défi pour rassembler ces influences contrastées en un son cohérent ?
Pour moi c’est l’inverse, et je sais que c’est étrange : le vrai défi pour moi serait de m’en tenir à un seul genre, une seule étiquette, un seul son. J’avais besoin de toutes ces couleurs différentes pour peindre ce tableau. Sans l’une d’elles, cela n’aurait pas eu de sens car ce ne serait pas la vérité. J’essaie de peindre un tableau et si on m’enlève mon vert et mon rouge, je dis « Non, j’en ai besoin ». Pour moi, c’était donc la chose la plus facile. C’était surprenant de voir quels genres je pouvais emprunter pour dépeindre ce tableau. Je pense que j’ai toujours été un artiste du collage.
Vous évoquez Bernard Herrmann et John Barry comme influences. Qu’est-ce qui vous a marqué dans leur écriture, et comment leur maîtrise du suspense et de l’atmosphère a-t-elle nourri votre travail sur Unfurl ?
Ils sont un peu différents l’un de l’autre. Ce qui m’intéresse dans la musique de cinéma, et qui la distingue des autres écritures instrumentales classiques, c’est qu’elle est au service du visuel. L’image raconte l’histoire : vous voyez un homme et une femme marcher dans un couloir. La même image peut être perçue différemment selon la musique. Si la musique est porteuse d’espoir, vous sentirez qu’ils vont vers quelque chose de beau. Si la musique induit du suspense, vous vous demandez ce qui va arriver. C’est là le rôle de la musique. C’est donc une musique faite de thèmes et de notes, mais conçue pour évoquer une émotion via l’orchestration, des transitions étranges de notes, et tout ça. C’est ce que j’aime profondément. J’ai les paroles, la scène. Mais comment les peindre pour en extraire encore plus d’émotion ? Je veux que vous marchiez dans le paysage précis que je veux vous montrer. Où apporter cela ? Autre chose que j’adore chez eux : la richesse d’une époque d’avant les ordinateurs, d’avant que l’on enregistre chacun dans son petit studio à la maison, ce que je fais habituellement, et c’est ainsi que j’ai écrit l’album. Mais l’idée d’une collaboration, cinquante personnes réunies dans une même pièce pour faire de la musique, chacune ayant pratiqué son instrument depuis l’enfance, et apportant son vécu dans un souffle de trompette ou dans le mouvement de l’archet, confère une richesse au travail collectif que j’aime profondément. On peut l’entendre : la richesse, l’abondance de caractère. J’adore cela et j’essaie vraiment de l’imiter.
/

/
Enregistrer aux studios Miraval, avec un orchestre live, a sans doute créé une énergie très différente de celle de vos précédents albums. En quoi l’environnement et le processus d’enregistrement ont-ils influencé les performances captées ?
Je pense qu’un disque est l’enregistrement d’un temps et d’un événement. Tout changement lié au temps, à l’événement ou au lieu modifiera le résultat enregistré. Donc, je ne dis pas qu’on ne peut pas faire un bon album dans une petite pièce, Billie Eilish et Finneas enregistrent dans une chambre et font de merveilleux albums. Mais, pour une raison ou une autre, longue histoire avec quelques noms célèbres, j’en suis arrivé là par sérendipité. Miraval est un studio de pointe : non seulement l’acoustique est parfaite, mais le traitement réservé à l’artiste est exceptionnel . C’est un hôtel vingt étoiles, pas cinq. Tout est pris en charge pour que vous puissiez seulement faire de la musique. C’est incroyablement inspirant, mais on a aussi le sentiment qu’il faut être à la hauteur. Tout le monde le ressentait. En parlant avec les musiciens, on avait l’impression qu’on nous traitait comme des artistes de premier plan, il faut mériter cela. On apporte donc son meilleur, et eux s’occupent de vous et sont là pour vous. Et simplement parce qu’ils vous traitent comme si vous étiez le meilleur artiste du monde, vous essayez d’y répondre. C’était une expérience tellement agréable et inspirante : vous n’avez plus qu’à penser à la prise, à ce qui manque, à écouter la musique. Vous n’avez plus à vous soucier de rien : ni de la technique – il y a suffisamment de techniciens–, ni de l’accueil. On vous sert exactement la nourriture que vous voulez, on s’occupe de vous, et vous vivez sur place. Il y a de beaux espaces, de belles chambres, tout est parfait. L’expérience vous autorise vraiment à vous investir pleinement dans la création de l’album. Je n’avais jamais connu ça auparavant. Et comme je produis beaucoup de mes albums, y compris celui-ci, je suis habituellement accaparé par une multitude de choses à gérer. Là, je n’avais plus ces préoccupations ; pour manquer d’un meilleur mot, c’était inspirant.
Au fil des années, vous avez toujours échappé aux étiquettes stylistiques. Le travail avec une formation orchestrale aussi puissante vous a-t-il donné un plus grand sentiment de liberté, ou au contraire introduit de nouvelles formes de discipline dans votre écriture ?
D’abord, il est important de dire que je ne me considère pas comme un musicien. Je connais de vrais musiciens, bien plus musicien que moi. Je ne lis pas les partitions, je n’ai jamais étudié la musique. Je viens du cinéma et de l’animation. Donc je n’ai pas étudié la musique de façon académique, je ne sais pas composer pour quarante instruments. En revanche, je peux m’asseoir devant mon ordinateur, écrire une mélodie au piano, en enregistrer une autre et dire « Ceci pourrait être pour les cordes », etc. C’est ce que j’ai fait. Puis j’ai travaillé avec un orchestrateur : je lui ai dit ce que je voulais, « Ecoute Bernard Herrmann, écoute John Barry », et lui a apporté ses propres idées, tentant de les traduire. Il travaille avec moi, mais il a ses espoirs, ses rêves, ses peurs, ses amours, ses ambitions, son ego, son goût. Du coup, ça sonne un peu différemment. Certaines idées partent à la poubelle, d’autres restent, et je me dis « Oh, je n’y avais pas pensé, je ne l’avais pas prévu ». Puis vient une autre étape avec les musiciens : on imagine un son, mais pour une raison ou une autre le violoncelliste a une mauvaise journée et ne joue pas comme prévu. Peu importe. Toutes ces petites choses qui arrivent demandent beaucoup d’humilité pour être acceptées. Si vous ne voulez pas que la saleté de l’expérience humaine s’immisce dans cette entreprise humaine, faites-le tout seul chez vous et mettez tout en autotune… Cela nécessite de la discipline, mais il y a aussi beaucoup d’aspects techniques : un orchestre pareil, on l’a pour un jour, on ne peut pas se le permettre davantage. Il faut que tout fonctionne et il faut être préparé. Il y a beaucoup de ce type de contraintes. Ces éléments humains « Je n’avais pas l’argent pour obtenir toute la violence sonore que je voulais », « J’ai dû rogner ici », « on n’a pas eu ça » font que parfois on doit choisir sur l’instant ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Toutes ces décisions difficiles sont ce qui rend la musique humaine, et j’adore ça. C’est partie prenante du processus collaboratif. Sur le moment, c’est pénible, vraiment. Mais rétrospectivement, je peux dire qu’une part de ce qui rend l’art beau, ce sont ses défauts humains. J’aimerais qu’on leurs accordent la beauté et la dignité qu’ils méritent.
En revenant sur votre parcours, de Different Pulses à Unfurl, que révèle ce nouvel album selon vous sur l’endroit où vous vous trouvez aujourd’hui – non seulement en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’individu ?
Ce qui a changé, c’est cette dissolution dont je parle : le noir et blanc n’existent plus. Le gris. Le gris est presque une religion pour moi : accepter le gris et ensuite le transmettre aux autres. Je pense que ce gris, surtout dans la réalité d’aujourd’hui, est important. La nuance, la complexité : voilà ce qui mène à une meilleure compréhension d’autrui. Il n’est pas nécessaire de tracer une ligne dans le sable et de dire « Ceci est noir, ceci est blanc », ni en musique (pop versus rock), ni en matière d’identité ou en politique : « Ceci est israélien, ceci est palestinien », « Ceci est républicain, ceci est démocrate ». Ces étiquettes, que l’on croit utiles pour comprendre le monde ou se situer soi-même, finissent en réalité par le fragmenter. Elles abîment nos relations. Elles minent notre capacité à accepter ce que la vie a de complexe, de flou, de chaotique et d’imparfait. Si je regarde mes albums, où je plonge de plus en plus dans ces domaines de confusion, j’essaie de plus en plus d’utiliser l’art pour glorifier et mythifier l’idée que nous pouvons vivre dans la confusion. Nous pouvons vivre avec la peur, habiter le lieu de l’ignorance et y trouver la dignité, comprendre que c’est là le plus proche de la réalité. Tout le reste que nous essayons d’ériger n’est qu’une tentative d’éloignement de ces constats. Je crois que cela devient problématique personnellement : on est moins vivant dans sa propre existence. Politiquement et globalement, c’est problématique car on devient obsédé par la recherche de définitions du soi . Et chaque définition du soi implique par défaut une définition contrastée de l’autre. Voilà ce que je ressens : c’est le chemin que je parcours. Comment me laisser aller à l’appel du flux, entrer dans cette rivière d’illusion du moi, être moins paniqué et réaliser que oui, c’est terrifiant, oui, c’est confus. Et probablement, par définition, je ne pourrai jamais le connaître ou le décrire exactement, et alors ? Qui a dit que je devais le faire ?
/
/
Unfurl est disponible via Telmavar Records. En concert à Paris (Grand Rex) les 4 et 5 novembre 2025.
/
/
Texte Blu Clara Rapps-O’Dea Valey
Image de couverture Faid A. Savant
/
/