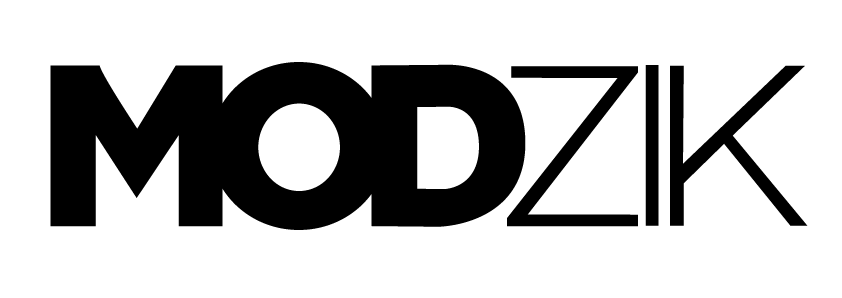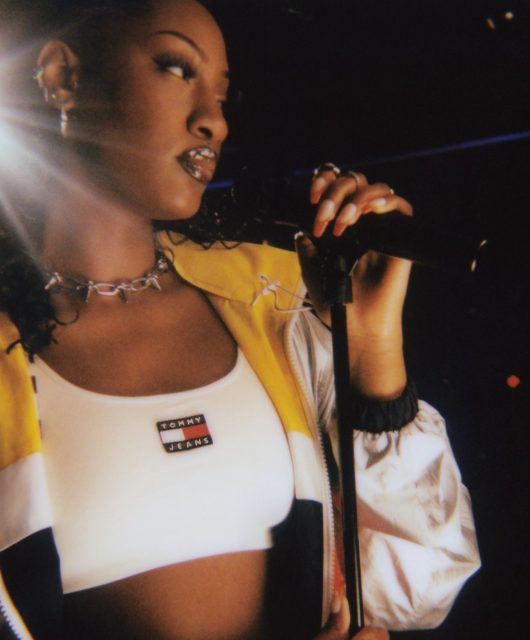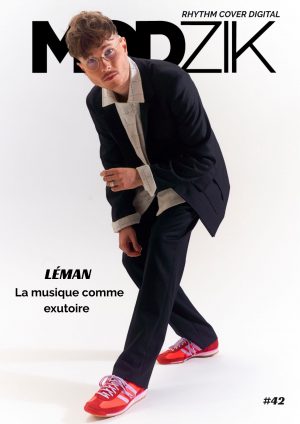/
Clap de fin pour une Fashion Week aussi émouvante qu’épuisante. Pendant une semaine, les yeux du monde entier ont été rivés sur la capitale française, mettant à l’honneur l’arrivée d’une dizaine de nouveaux directeurs artistiques à la tête des plus grandes maisons. Entre ruptures audacieuses et volontés de continuité, les marques ont rivalisé d’ingéniosité pour se démarquer, optant chacune pour des stratégies créatives bien distinctes.
/
/
« La Fashion Week du siècle », dans un siècle de crise
Élue comme « la Fashion Week du siècle » par le monde de la mode, la semaine des défilés printemps-été 2026, qui s’est tenue du 29 septembre au 7 octobre à Paris, a marqué un tournant historique. Et pour cause : plus d’une dizaine de maisons emblématiques ont fait le choix de renouveler leurs directions artistiques cette saison. Sur la liste des nommés, on retrouve Matthieu Blazy chez Chanel, Jonathan Anderson chez Dior, Alessandro Michele chez Valentino, Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga, Miguel Castro Freitas chez Mugler, ou encore Duran Lantik chez Jean Paul Gaultier. Avec plus de 110 maisons de mode inscrites au calendrier officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, cette Fashion Week témoigne de l’avènement d’une nouvelle ère créative dans la mode, mais est également le signe d’une crise économique qui traverse le luxe.
Ces changements interviennent dans un contexte économique particulier pour l’industrie du luxe. Pour la deuxième année consécutive, le secteur du luxe observe un ralentissement avec baisse de 2% en 2024 et 2025. Plusieurs facteurs, qui sont à la fois macroéconomiques, géopolitiques et sociologiques, expliquent cette tendance. D’abord, l’inflation généralisée a poussé les marques à augmenter leurs prix à partir de 2022. Cette hausse a freiné la consommation, notamment chez les clientèles les plus jeunes ou les plus volatiles. Les tensions géopolitiques ont également eu un impact direct sur la consommation. En particulier, la nouvelle politique douanière mise en place par Donald Trump en avril 2025 complique les échanges entre les États-Unis et l’Europe, affectant lourdement les exportations françaises de produits de luxe. Enfin, le profil du consommateur de luxe est en pleine évolution. Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG), les jeunes générations, notamment en Chine, semblent se détourner des grandes maisons. Elles se disent saturées par une communication omniprésente tandis que la qualité perçue des produits de luxe n’est plus toujours à la hauteur des attentes.
Entre innovations stylistiques et réalités commerciales : Dior et Chanel
« Do you dare enter the House of Dior? » (« Oserez-vous entrer dans la Maison Dior ? ») : tel était le message projeté sur un écran géant à l’ouverture du tout premier défilé, très attendu, de Jonathan Anderson pour Dior. Avant même l’apparition des premiers mannequins, le créateur irlandais a présenté un film d’archives retraçant l’héritage de la maison à travers ses prédécesseurs, de Christian Dior à Maria Grazia Chiuri, en passant par John Galliano. Bien plus qu’un simple hommage, cette séquence introductive avait valeur de manifeste : elle rappelait aux clients que Dior est une maison dont la force réside dans sa capacité à évoluer avec son temps. Une manière pour Anderson de remercier, avant de s’imposer. Pour le printemps-été 2026, le designer est allé puiser dans les archives de la maison, réinventant notamment le célèbre tailleur Bar et la jupe Junon en version mini. Il a également réintroduit les chapeaux dans le vestiaire féminin, clin d’œil au passé de Christian Dior, qui a débuté sa carrière en vendant des croquis de chapeaux aux modistes parisiens. Parmi les pièces phares, on retrouve une nouvelle édition du sac Lady Dior, promis à un succès commercial. Fière de ses 73 looks, la collection rend hommage à l’héritage de la maison tout en y injectant la touche plus architecturale et avant-gardiste propre à Anderson. Toutefois, certains critiques ont pointé un manque de prise de risque. Connu pour son goût prononcé pour l’expérimentation stylistique, le créateur a ici proposé une vision jugée parfois trop sage.
/

/
Le défi était tout aussi ambitieux pour Matthieu Blazy, qui présentait le 6 octobre son premier défilé pour Chanel. Comme chez Dior, la scénographie a joué un rôle clé. Fidèle à la tradition de la maison, le défilé s’est tenu au Grand Palais, plongé cette fois dans une ambiance cosmique : les mannequins défilaient autour de représentations monumentales de Vénus, Mars et Pluton. Blazy s’inscrit dans la lignée de Karl Lagerfeld en proposant un décor spectaculaire, tout en établissant un dialogue symbolique avec Coco Chanel. Sa collection est pensée comme une conversation avec la fondatrice, remplie de références aux archives de la maison. On retrouve un important travail de tailoring : des tailleurs-jupes légèrement oversize, des silhouettes androgynes évoquant l’intérêt de Chanel pour le vestiaire masculin, et un tweed en trompe-l’œil, non pas tissé, mais conçu en maille stretch boutonnée. Le tout compose un vestiaire pensé pour les femmes modernes, tel que Gabrielle Chanel aurait pu l’imaginer. Le défilé a été salué par la critique, notamment lors de son final vibrant : le mannequin Awar Odhiang, tout sourire, a clôturé le show en frappant dans ses mains sous les applaudissements.
/

/
Le retour aux sources d’Yves Saint Laurent et Balmain
Dans un climat de changement, certaines maisons ont choisi de revenir à leurs fondamentaux. C’est le cas d’Yves Saint Laurent, dirigée depuis neuf ans par Anthony Vaccarello. Le créateur belge s’est inspiré d’une archive retrouvée récemment, dans laquelle Françoise Giroud, ex-ministre de la Culture dans les années 1970, décrivait la femme Saint Laurent comme une « comtesse de la nuit ». Vaccarello a puisé dans cette image pour construire un vestiaire à la fois chic et rebelle, fidèle à l’essence de la maison. Le défilé a révélé des vestes en cuir épais à manches ballon, portées avec des chemisiers blancs en popeline ornés de nœuds papillon lâches, ou encore des trench-coats à col montant. Présenté, comme souvent, au pied de la Tour Eiffel, le show ancre encore une fois l’identité Saint Laurent dans un Paris à la fois intemporel, mystérieux et libre. Face au tumulte ambiant, Vaccarello semble avoir choisi de maintenir le cap : revenir à l’ADN de la maison plutôt que de céder aux sirènes de la nouveauté à tout prix.
/

Même approche chez Balmain, où Olivier Rousteing a présenté pour l’été 2026 une collection placée sous le signe de l’évasion. Inspiré par le succès viral de la fameuse sand dress portée par la chanteuse Tyla au Met Gala l’année précédente, le créateur a imaginé une garde-robe estivale décontractée, pensée pour des vacances en bord de mer. Sarouels, robes coquillage, serviettes de bain transformées en vestes : la collection se veut plus casual qu’à l’accoutumée. Rousteing explique avoir voulu montrer une autre facette de la femme Balmain, moins guerrière, mais pleine d’assurance : « Cette fois-ci, il s’agit davantage de confiance en soi. Ce n’est pas une armure, c’est la liberté ». Dans un contexte d’incertitude, Rousteing a choisi la simplicité comme réponse. Un retour à une mode plus épurée, pensée pour durer. « Quand on travaille dans la mode, on vit des moments d’engouement, mais aussi des moments où cet engouement s’estompe. Et je dirais à mon moi plus jeune : ‘Ne cherche pas à être à la mode, cherche à être intemporel, car il n’y a rien de mieux que de rester éternel’ », a-t-il confié au magazine WWD.
/

/
/
Texte Alizée Morais
/
/