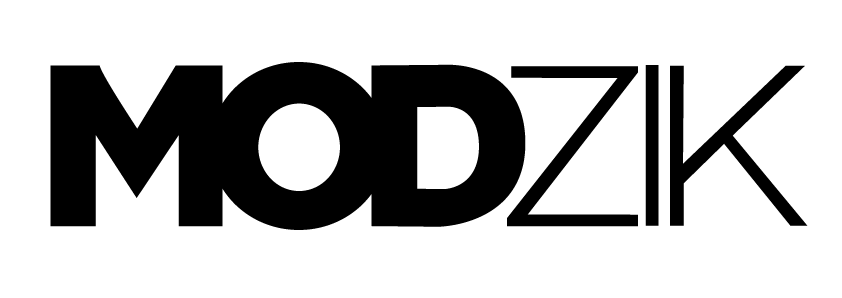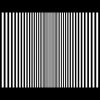Je m’appelle Safia Bahmed-Schwartz, et je suis née le 11 avril 1986 à Strasbourg.
Texte : Safia Bahmed-Schwartz
Photographie : Zelinda Zachinelli
La façon dont on grandit prédétermine évidemment ce que l’on devient, ce que l’on fait, ce que l’on crée. Certes, mais la raconter est une autre histoire. Alors disons que je suis issue d’une famille implantée dans l’industrie pharmaceutique, fille d’un père Algérien et d’une mère Allemande. Petite, je ne manquais de rien – j’étais plutôt dans le trop que le pas assez. J’avais plein d’activités extra-scolaires, je faisais plusieurs sports, j’avais un poney, je pratiquais aussi plusieurs instruments, du piano, de la harpe, du saxophone, et j’allais à la chorale et au solfège même si je n’y comprenais pas grand-chose. Je suivais aussi des cours de physique chimie pour enfants. Ce qui me passionnait vraiment, c’était de faire des photos et des vidéos. Très jeune, j’avais toujours le dernier modèle d’appareil. J’adorais documenter ma vie, celle de ma famille, inventer des histoires, en faire de petits films.
J’étais dans le 91, à Corbeil-Essonnes, découvrant que l’absinthe de Van Gogh avait été remplacée par le shit et le Jack Daniels.
Je dessinais, évidemment, mais comme le font les enfants, je voyais beaucoup d’expos, d’ateliers pour artistes en herbe – Vincent Van Gogh me fascinait, j’avais visité sa maison, celle de Monet aussi, avec son jardin, ses nénuphars, tout ça – je le prenais en photo, je le filmais, je racontais son histoire à ma façon. Très vite, j’ai compris que l’environnement dans lequel on évoluait était le background d’une œuvre. Je l’ai compris inconsciemment. À 11 ans, un incendie a ravagé notre maison ; mes parents y sont restés, j’ai également perdu toutes mes affaires et surtout mes films et photos. Sans famille directe, j’ai d’abord été placée dans un internat, sans aucun repère. J’étais ingérable. J’ai alors été placée en famille d’accueil, en banlieue parisienne – c’est drôle comment on peut acquérir de la street-cred quand on a grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Évidemment, je devais toucher un héritage, mais j’étais mineure. Et puis surtout des membres éloignés de la famille se le disputaient. J’étais dans le 91, à Corbeil-Essonnes, découvrant que l’absinthe de Van Gogh avait été remplacée par le shit et le Jack Daniels. Même si ça n’a jamais été une « passion », la musique a toujours fait partie de ma vie, j’ai grandi avec, sans en comprendre les bases malgré les cours que j’avais suivis, j’en ai toujours écouté. La chanson arabe et la musique classique étaient maintenant remplacées par le hip-hop et la variété française que je ne connaissais pas auparavant.
J’écrivais par période, parfois je n’y arrivais plus, toutes ces femmes étaient des visages, des corps, des corps sans visages.
Faire le deuil de mes souvenirs et archives était dur, je ne voulais plus toucher à un appareil photo. J’ai alors commencé à écrire, je tenais un journal, pas vraiment intime, j’y racontais des histoires, y tenais des comptes précis et autres calculs de physique. J’y écrivais aussi des poèmes. À cette période, ça n’allait pas très bien. Au-delà de mes problèmes d’adolescente, je faisais semblant d’aller bien, mais au collège, c’était une catastrophe. En commun accord avec ma famille d’accueil, la conseillère d’orientation m’a inscrite en CAP esthétique. Ce n’était pas vraiment ce à quoi me prédestinaient mes parents mais peu importe. J’y étais, entourée de beaucoup de filles, à apprendre les bases de l’esthétique et afin de rester dans un domaine artistique, j’ai décidé de devenir make-up artiste.
Très vite, j’ai fait des stages professionnels, dont un en particulier m’a beaucoup marqué ; c’était en « partenariat » avec la prison de Fleury-Mérogis, suivi d’un autre dans un salon de soin pas très loin des Champs-Élysées. Celui en prison, c’était surtout apporter de la vie, de l’humanité aux détenues, c’était reconstructeur ; des histoires, j’en ai entendues. Dans le salon du 8e arrondissement de Paris, c’était aussi de l’humanité, j’y ai entendu aussi beaucoup d’histoires. Toutes ces pérégrinations sont devenues des nouvelles dans mes carnets. J’écrivais par période, parfois je n’y arrivais plus, toutes ces femmes étaient des visages, des corps, des corps sans visages. C’est à cette période que j’ai décidé de devenir artiste, à ce moment-là que j’ai eu envie de magnifier la misère de plein de formes différentes, la peine, la souffrance. Jouer à la magicienne. Néanmoins je ne savais pas encore comment. Lorsqu’à 18 ans j’ai enfin touché l’argent qui me revenait, j’ai d’abord pensé à monter mon propre salon. Je l’ai fait, ça a duré un an, je n’avais plus le temps de rien, ni d’écrire, ni de penser.
Parfois je dessine des souvenirs, par peur qu’ils ne s’effacent, pour revivre précieusement chaque instant de ce moment jusqu’à ce que l’esquisse soit finie.
Un soir sur Myspace, vénère, je cherchais un moyen de clasher quelqu’un, un ex je crois, je ne trouvais ni les mots, ni les images, et encore moins de gif animé. Alors j’ai pris une feuille blanche, un feutre noir et j’ai dessiné un truc. Le dessin terminé, je me suis émerveillée : « Ah ouais ! Putain ! Je sais dessiner » (très fière de ma connerie). Fascinée par ce que j’arrivais à représenter, je me suis mise à dessiner tous les jours, enchantée par ce qui apparaissait en noir sur ces feuilles blanches. Je ne sais plus à quel moment c’est devenu vital. Ce que je sais, c’est que j’ai besoin de dessiner tous les jours, le jour ou la nuit, en fonction du moment qui s’y prête, du temps que j’ai. Aussi vital que manger ou dormir. Souvent, je rate des rendez-vous, au mieux je suis en retard parce qu’il faut que je dessine. Souvent, je m’extirpe d’endroits ou de situations juste pour ça. J’en oublie de manger, je me réveille exprès. De la même façon que certains sont obsédés par la masturbation ou le sexe, je dois satisfaire ce besoin assez régulièrement. Le jour, c’est pour exprimer ce que je ressens profondément.
Maintenant, j’ai bien conscience que le bon dessin, les bons traits, juste assez de noir sur le blanc suffit à dire, à délester, il n’est plus questions de langues, nique reverso. Certainement qu’en tatouant mes dessins, j’ai aussi compris qu’on pouvait faire passer des messages sans rien dire, juste en se dévêtissant un peu, beaucoup… La nuit aussi je dessine des messages, que des mots rendraient trop cheesy, ou trop violent, trop fort à entendre ou juste à lire, que j’adresse à l’un ou à l’autre. Parfois je dessine des souvenirs, par peur qu’ils ne s’effacent, pour revivre précieusement chaque instant de ce moment jusqu’à ce que l’esquisse soit finie. Parfois il est juste question de fantasme, d’envie. Parfois je n’y arrive pas, et c’est comme si je n’arrivais plus à bander. Puis le trait revient, d’abord fébrile, puis vibrant, ainsi je jouis à nouveau. C’est après cette soirée de clash sur Myspace que je me suis barrée. Dessiner m’excitait, me donnait des ailes, je suis montée dans un train et je suis partie. D’un train à un autre, d’une ville à une autre. Souvent je recontactais ma famille d’accueil, les parents n’avaient jamais remplacé les miens mais leur fille était comme ma grande sœur. Elle avait seulement quelques années de plus que moi, juste assez pour que l’on soit assez proches. Un peu avant mon départ, elle s’était convertie à l’islam et avait décidé de me donner tous ces CD car elle avait entendu que le châtiment pour ceux qui écoutaient de la musique était du plomb brûlant versé dans leurs oreilles. C’est comme ça que j’ai découvert Oxmo Puccino, Lunatic et Booba avec son fameux Temps Mort. En réalité la première fois que je l’ai écouté, c’était avec mon premier vrai mec, Hamadi. C’est en Mercedes Classe A qu’il est venu me chercher. Hamadi était un jeune homme de 19 ans, du 19e, et les moyens, il les avait.
C’est devenu la BO de cette histoire, la BO de ce souvenir. À chaque voiture qu’on croisait, c’était la même voix, les mêmes paroles, le même son qui en émanait.
Je me souviens comme si c’était hier qu’on roulait, d’un point A à un point B, de ce point B à un point C, beaucoup. Dans la voiture, on écoutait la même cassette, la même face, arrivée à la fin, de suite rembobinée. J’y ai pris goût, j’avais pas vraiment le choix, c’est devenu la BO de cette histoire, la BO de ce souvenir. À chaque voiture qu’on croisait, c’était la même voix, les mêmes paroles, le même son qui en émanait. Je ne me souviens pas de la première fois où nous nous sommes embrassés. Ça devait être au moment de se quitter, à la fin d’une des journées, soirées qu’on avait passé ensemble, à rouler. Puis un soir, un pote a appelé pour me dire qu’Hamadi était à Fleury. Mais j’étais déjà partie, j’ai tenu malgré la distance une longue relation épistolaire avec lui, aussi longue que sa détention, qui n’a pas duré des années. Booba je l’écoute toujours, au moins un titre par jour, fréquemment Temps Mort . Il m’est arrivé après de l’occulter, de passer outre, puis d’y revenir, pour finalement réaliser qu’il devenait intemporel, qu’il traversait les années, les décennies, que son œuvre ne se limitait ni au 19e, ni au 91, ni à certaines classes sociales. Quand ma maison d’édition fut créée après l’édition de mon premier livre « Apprenons à lire », un recueil de textes, j’ai décidé de lui dédier un livre, auquel une sélection d’artistes contemporains a participé. Car aimé ou détesté, il était devenu une icône, le représentant d’une, voire de plusieurs générations.
Entre-temps, ma grande sœur est devenue une hippie. Elle m’a accompagnée pendant un temps dans mes voyages. Elle était là lorsque j’ai appris le violon dans une famille tzigane, jusqu’à ce que je m’installe à Londres, où je bossais dans une galerie. Un petit boulot en entraînant un autre, je me suis retrouvée à Los Angeles où je bossais pour Getty, d’abord dans l’image, puis au musée. J’ai appris à connaître et à aimer la musique de la West Coast, à comprendre les textes avec des potes rencontrés à Compton. Et aussi l’art contemporain. Ce fut difficile mais j’ai compris que je pouvais, voire que je devais refaire de la vidéo. Mais je n’avais plus autant les moyens alors j’ai volé un appareil et une caméra. Que j’ai toujours aujourd’hui. Caméra avec laquelle j’ai tourné dernièrement mon clip « JTM ». J’ai appris à me servir des logiciels. J’adorais distordre les images – la réalité n’est-elle pas ce qu’elle donne à voir? Alors je me suis lancée dans une très longue série d’autoportraits. Je plaçais mon visage sur une multitude d’images, photos, arches, peintures, captures. Au fil des années, je me suis lassée du dessin, je voulais lui trouver une autre forme, un autre support. J’ai commencé à me tatouer dans un train, après avoir perdu toutes mes affaires de dessin, il ne me restait qu’un stylo-bille, j’ai arraché un morceau de l’accoudoir et je me suis tatoué un logo Nike. Les logos, les marques, les idées et images qui véhiculent me fascinent. Et puis je suis une gosse de la pub. Pour moi, manger des Frosties rend plus fort ! Avoir une Mercedes rend heureux ! À l’époque, je fréquentais un mec qui m’a dit « Entraîne-toi sur moi jusqu’à ce que tu réussisses ». Alors je l’ai tatoué, une fois, deux, trois, quinze, vingt fois, lui, moi, puis d’autres. Ça a influencé mon trait, ma façon de dessiner, voir mes dessins se mouvoir sur le corps de personnes, les écouter se raconter, dans la douleur, à moitié dénudées, était une expérience extraordinaire. Quand j’ai maîtrisé assez de techniques, j’ai décidé de parcourir le monde pour aller me heurter aux histoires, aux douleurs des autres – Paris, Berlin, New York, Beyrouth, Oslo, Londres, Tokyo.
Aujourd’hui, je suis revenue à mon premier amour. Paris, je dessine toujours, j’écris toujours, je ne tatoue plus, c’est une période révolue. Je ne suis pas tatoueuse, j’écris pour mettre en musique, pour ensuite clipper, réaliser les vidéos qui mettent en images mes mots. J’édite toujours des livres, certains textes méritent d’être en noir sur des pages blanches. Parfois je fais de la sculpture, parfois je fais du dessin animé, parfois du métal, parfois je produis de la musique – il est seulement question de trouver la forme idéale pour transmettre une idée. Des maux, mais de la plus belle façon possible.
_