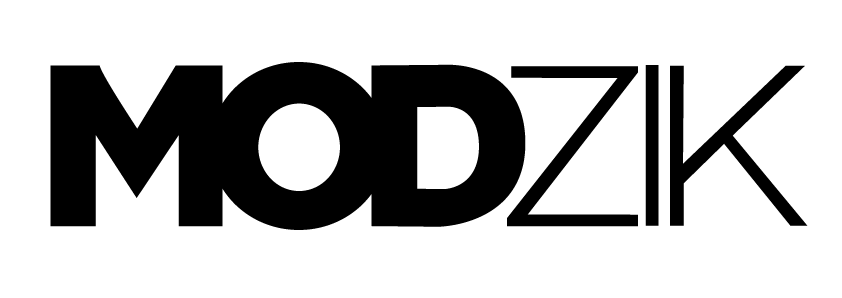/
NEWS!
/
/
Hommage à la culture latino-caribéenne, ode à l’amour et à Puerto Rico, manifeste de fierté : la prestation de Bad Bunny au Super Bowl était attendue, et elle a tenu toutes ses promesses. Qué rico ser latino !
Il est 2h du matin en France et nous sommes des milliers devant nos écrans, à attendre patiemment le show de Bad Bunny. Le football américain importe peu ; ce qui compte, c’est ce moment de visibilité. Celui d’une représentation à l’international, rare, précieuse. Dans le contexte actuel, la présence de Bad Bunny dépasse le simple cadre musical. Il incarne une fierté culturelle qui se revendique sans compromis. Alors que l’atmosphère politique aux États-Unis demeure tendue et que les communautés latinas continuent d’être marginalisées dans les discours et les politiques publiques, voir un artiste portoricain occuper l’une des scènes les plus regardées au monde prend une dimension particulière. L’histoire des relations entre les États-Unis et les territoires latino-caribéens a toujours été complexe ; cette performance s’inscrit, elle aussi, dans cette continuité.
Avant même la première note, la présence de Bad Bunny sur la scène du Super Bowl promettait un moment d’envergure. Une performance pensée comme un langage visuel.
/

/
Les tenues
Le show s’ouvre sur une immersion totale dans la culture portoricaine : « Qué rico ser latino » (Quel bonheur d’être latino) résonne avant de plonger les spectateurs dans des champs agricoles où apparaissent des jíbaros coiffés de pavas, chapeaux traditionnels tressés en feuilles de palmier. Figures emblématiques de l’île, ces agriculteurs de canne à sucre convoquent l’histoire des plantations, la mémoire des travailleurs et les racines d’un peuple façonné par la terre.
Bad Bunny apparaît chaussé de ses premières baskets en collaboration avec Adidas, vêtu d’une tenue crème Zara : chemise à col et cravate, maillot floqué du numéro 64. Un chiffre intime, l’année de naissance de sa mère, Lysaurie Ocasio. Mais aussi profondément politique : 64, comme le nombre de morts officiellement recensés après l’ouragan María en 2017, là où les spécialistes estimaient le bilan réel à près de 4 000 victimes. Pour un événement de cette ampleur, le luxe était attendu. Il choisit le contraire. Zara devient symbole de proximité, marque universelle dont l’origine espagnole rappelle l’histoire coloniale de l’île. Le vêtement se transforme en message.
/

/
En parallèle, Lady Gaga porte une robe Luar, signée par le créateur dominicain Raúl López, inspirée des danseuses de flamenco et teintée d’un bleu rappelant le drapeau de l’indépendance portoricaine. Les danseurs arborent des silhouettes Yomás, marque portoricaine fondée par Jomary Segarra. Le podium du Super Bowl se transforme alors en vitrine de la création caribéenne contemporaine : voir ces noms, ces esthétiques, ces références sur une scène mondiale relève d’un moment rare, presque réparateur.
/

La scénographie
La scène reconstitue la vie quotidienne portoricaine, mêlant île et diaspora : bodegas colorées de New York, l’iconique La Casita rose, stands de piragua (glace pilée en cône nappée de sirops), de coco frío et de tacos, champs de canne à sucre verdoyants. Une géographie affective se dessine sous nos yeux. La terre natale et l’exil ne s’opposent plus : ils dialoguent. Les nail salons et beauty shops occupent aussi l’espace, rappelant que les codes de la beauté mondialisée prennent racine dans les communautés immigrées. Ongles, coiffures, esthétiques : autant de gestes transmis, transformés, célébrés.
/

/
Autour de Ricky Martin, interprétant Lo Que Le Pasó a Hawaii les plantains symbolisent les racines, la famille. Une image simple, organique, immédiatement reconnaissable pour toute une diaspora.
/

/
Perché au sommet d’un poteau électrique, Bad Bunny transforme la scène en allégorie politique. L’image évoque les coupures chroniques qui frappent Puerto Rico. Avec El Apagón, il transforme la panne en cri collectif, dénonçant la négligence et le désengagement du gouvernement américain envers l’île.
/

/
La caméra s’attarde ensuite sur un salon familial : une mère, un père, un enfant regardent son discours des Grammy Awards. En offrant symboliquement son trophée à l’enfant, il opère un passage de relais. Son succès devient héritage. Aussi, l’apparition de Toñita, figure du Caribbean Social Club de Williamsburg, ancre la performance dans l’histoire réelle de la diaspora. Enfin, l’image d’un enfant endormi sur deux chaises au milieu d’un mariage agit comme un symbole intime et universel. Grandir au rythme des fêtes, s’endormir sur des lits improvisés pendant que la musique continue : une scène partagée par des générations entières latino-caribéennes.
/

/
Et soudain, à travers un écran, ce souvenir collectif devient visible au monde entier. Un véritable mariage est célébré sur scène. Message clair : « La seule chose plus forte que la haine, c’est l’amour ». Le spectacle devient réparation.
/

/
En conclusion, Bad Bunny lance un « God Bless America » qu’il élargit à tous les pays d’Amérique du Nord, Centrale, du Sud et d’Amérique Latine. L’Amérique est plurielle, diasporique, partagée. Ce final élargit la notion même d’« Amérique » à un territoire affectif et culturel partagé, une Amérique plurielle, façonnée par ses peuples, ses diasporas et ses mémoires.
/

/
Un moment puissant, chargé de sens, qui dépasse le cadre du spectacle et s’inscrit dans la mémoire collective
Bad Bunny, au cœur de l’actualité, enchaîne récompenses et sommets tout en restant fidèle à ses convictions. Prises de position assumées, art utilisé comme langage engagé : il livre ici un moment historique, à la croisée de l’amour et de la résistance. Cette performance a résonné dans nos cœurs. Le temps d’un instant, un peuple s’est senti entendu, écouté, pleinement représenté. Un moment puissant, chargé de sens, qui dépasse le cadre du spectacle et s’inscrit dans la mémoire collective, laissant derrière lui une émotion durable et une fierté partagée.
Texte Nefertari Remir
Image en couverture @liljupiterr