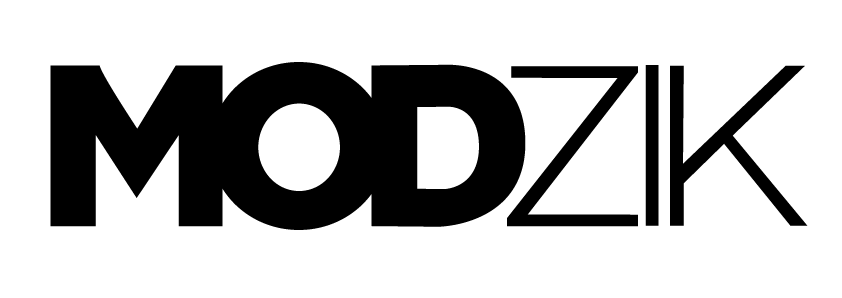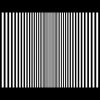Parler de street art à Londres, c’est inévitablement penser au travail de Banksy , artiste productif et controversé qui officie dans cette ville depuis plus de dix ans. Figure emblématique de l’art urbain anglais, il a ouvert la voie aux jeunes artistes en mal de reconnaissance. Hin est un des nombreux artistes à s’être engouffré dans la brèche Banksy. La rue londonienne est pour lui un terrain de jeu qui ne demande qu’à accueillir ses créations entre lignes hyper-précises et traits enfantins. Il ne cache d’ailleurs pas l’influence de Banksy sur le street art : « Il y a vraiment eu un avant/après Banksy. Quand il a commencé, personne ne savait qui c’était. Il s’attaquait à des sujets sensibles, alors parfois ses pièces se faisaient recouvrir. A l’époque, on pouvait se faire jeter en prison pour une pièce jugée controversée. Maintenant les choses ont changé, grâce à Banksy, la société et surtout le gouvernement anglais ont changé de discours, en disant qu’ils ont toujours aimé ce moyen d’expression. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ils l’aiment parce qu’ils savent maintenant que ce genre d’art peut être marketé. » Depuis, les choses ont changé dans le paysage urbain anglais. Un site dédié au street art londonien a été ouvert, et des tours avec guides sont organisés pour découvrir la création street. La ville laisse à peu près tout faire, et les dessins se font très rarement recouvrir par les employés municipaux, de peur de gâcher l’œuvre d’un futur Banksy. Hin raconte : « Je n’ai jamais été arrêté. Quand la police vient me voir, ils sont plutôt dans une démarche de discussion. Ils vérifient qu’on a les autorisations de dessiner sur tel ou tel mur, et s’assurent qu’on ne fait rien de scandaleux. Les flics sont plutôt du genre à te faire des blagues et à te dire que tu as oublié de peindre un coin de mur. »
L’est londonien : berceau du street art
En quatre ans, l’est londonien notamment, a complètement changé de visage. A Brick Lane, impossible de ne pas tomber sur un tag, un graff ou un dessin. Quartier jeune et bourré d’artistes, l’Est n’a plus de secret pour Hin qui dessine de Brick Lane jusqu’au quartier branché d’Hackney. En promenade avec lui, il nous explique les ficelles : « Aujourd’hui, on peut vraiment faire tout ce qu’on veut dans l’est, et nos créations sont plus ou moins respectées. Parfois, un graffeur tague sur un dessin… Du coup, il y a des petits incidents parfois, mais on essaye vraiment de faire disparaître ce vieux cliché des bagarres entre graffeurs, au final on est tous des street artistes, la rue est à nous tous, c’est le jeu. » A Redchurch street par exemple, Hin a dernièrement posé une Vierge Marie portant le costume de Wonderwoman, une allégorie sur les croyances des Hommes qui n’a visiblement pas été au goût de tout le monde : « A partir du moment où tu touches des sujets comme la religion ou la politique, ça devient compliqué. A chaque fois que je reviens ici, je remarque que la tête de ma Vierge Marie est arrachée, c’est comme ça… » Cette fois il découvre qu’un autre artiste a remplacé la tête de la Vierge Marie par une tête de mort. D’autres surprises parfois, à Broadway Market par exemple, où certains de ses dessins, ont été recouvert, probablement par les propriétaires de boutiques eux-mêmes qui craignent qu’un dessin n’encourage la prolifération de graffs sur leurs murs. Certains apprécient, d’autres non.
Des dessins naïfs et précis
Un art souvent critiqué, parfois éphémère, difficilement rentable pour les artistes. Alors pourquoi choisir le street art quand on peut vendre des toiles ? Pour Hin, c’est un choix qui s’est imposé de part sa fascination pour les gens : pourquoi voir petit format, petite exposition quand on peut être au plus proche de la société en s’appropriant la rue ? Dans son travail, Hin cherche donc des images qui parlent au plus grand nombre : Gandhi, Ronald McDonald ou John Lennon par exemple. Il façonne ces personnalités publiques à sa manière, un travail sérieusement agrémenté de dérision. Pour cela, il utilise deux techniques : pour les visages, il appose des lignes très précises dessinées à la main droite grâce à un crayon à la mine très fine et pour la partie colorée, il utilise sa main gauche et des craies grasses, une manière de conserver une insouciance gestuelle proche de l’enfance. Son travail est donc assez paradoxal mêlant naïveté et cruauté du monde : « Je me trouve toujours au milieu d’une contradiction, j’aime quand deux mondes se répondent. »
Londres : amour/haine
Une contradiction omniprésente dans la vie de l’artiste arrivé à 12 ans en Angleterre avec comme rêve de devenir footballeur professionnel. Envoyé par ses parents en internat, il est très distrait à l’école et ne pense qu’au ballon rond, jusqu’au jour où une fracture du genou l’empêche de continuer. Hin doit alors se remettre en question et son père lui conseille de faire quelque chose qu’il a toujours aimé : le dessin. « J’ai vraiment de la chance dans le sens où en temps normal les familles veulent que leurs enfants deviennent médecin ou avocat… Mais depuis tout petit je dessinais, étant hyperactif, c’est la seule chose qui me calmait et qui permettait à mes parents de se reposer un peu. Quand j’avais un crayon en main, plus rien ne se passait. » S’en suit donc une école d’art avec son lot de formatage et de déceptions, et quelques expositions. Après un an passé à peindre à Bruxelles, il décide de revenir à Londres se considérant suffisamment mûr pour affronter le monde de l’art de la capitale anglaise :« Ici l’art, c’est comme le monde des finances : toujours cette compétition, toujours cette prétention. Londres est une super ville pour montrer son boulot, moins pour se construire. J’adore cette ville, cette mixité, le fait qu’Espagnols, Africains, Anglais, pauvres, riches se côtoient, c’est très inspirant. Je la déteste pour cette concurrence. Pour y arriver, il faut vraiment être flexible. » Et flexible il l’est. Ne gagnant pas beaucoup d’argent avec ses créations urbaines, Hin touche à tout : il créé des sculptures, des produits : céramiques, assiettes, tasses (qu’il vend entre autres à Liberty, sorte de Galeries Lafayette anglais) ou encore des illustrations qu’il imprime à plusieurs exemplaires et que quelques galeries présentent. Aujourd’hui, il vit de son art, chose assez rare pour être soulignée, et commence à montrer son travail un peu partout. Fasciné par l’art brut, il avait d’ailleurs fait le tour des ateliers dans le sud de la France et avait participé grâce à Danielle Jacqui, artiste et fondatrice du festival d’art singulier à Aubagne, à une exposition collective. De ville en ville et de voyage en voyage Hin laisse quelques traces, de plus en plus. Ses projets ? Avec l’arrivée des beaux jours, reprendre le travail street, organiser une exposition intimiste et partir. Partir, pour mieux rayonner.
Par Cécile Becker